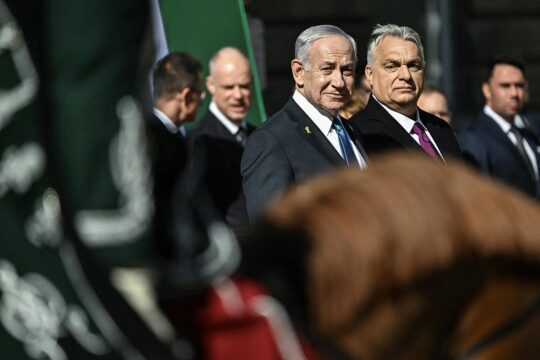JUSTICE INFO : Combien de "communications" avez-vous envoyées à la Cour pénale internationale (CPI) ?
ANDREAS SCHÜLLER : Nous avons commencé il y a une dizaine d'années sur la Colombie. Au total, nous avons eu trois grosses communications sur les crimes contre l'humanité, sur la violence de genre et sur la violence contre les défenseurs des droits de l'homme. Ensuite, sur l'Irak et le Royaume-Uni, nous avons soumis une communication majeure, puis trois ou quatre communications de suivi entre 2017 et 2020. Sur le Yémen et le commerce des armes, nous avons également déposé quelques communications de suivi, plus petites. Sur la Libye, nous avons fait deux grandes communications à la fin de l'année dernière et à la fin de l'année précédente. Et puis, sur l'Afghanistan et surtout sur la torture par les Américains, nous avons également communiqué à plusieurs reprises avec le Bureau du Procureur.
Quelle est l'ampleur de ces communications ?
Cela varie beaucoup d'une situation à l'autre. La première peut être une communication de 200 pages, puis des communications de suivi plus ciblées de 3 à 20 ou 40 pages.
Combien de temps faut-il pour les préparer ?
En général, nous y consacrons près d'un an, avec une équipe de deux ou trois rédacteurs, puis une autre équipe de quatre ou cinq personnes, dans les organisations partenaires, qui relisent, avec chacune leur rôle. Cela prend donc pas mal de temps. Il s'agit toujours d'une combinaison d'analyses juridiques de la situation, d'analyses factuelles, mais aussi, plus spécifiquement, d'indications directes sur les preuves : où se trouvent-elles, comment le Bureau du Procureur pourrait-il les obtenir, et parfois aussi ce qui a déjà été fait par les unités nationales chargées des crimes de guerre. Nous montrons donc un peu le contexte de ce qui se passe déjà, et comment nous ferions les choses, au moins pour commencer.
Quel est le niveau de suivi ?
Cela varie sur le temps et selon la situation, mais dans tous les cas, nous assurons un suivi actif. Si nous ne demandons pas activement un suivi, nous aurons peu de retours. D'après mon expérience, lorsque nous venons à La Haye et demandons une réunion, c’est toujours possible. Mais ce qui nous manque, ce sont des décisions et des réponses écrites. Je veux dire, sur le Royaume-Uni et l'Irak, il y en a une, qui justifie la décision de ne pas poursuivre l'examen préliminaire à l'époque. Mais par exemple, pour la Colombie, nous n'avons jamais rien reçu. Nous n'avons jamais reçu de réponse sur la façon dont ils considèrent nos soumissions, s'ils pensent qu'il existait un soupçon initial ou des motifs raisonnables de croire que des crimes avaient été commis ou s'ils pensent que cela ne relève pas de leur compétence. Et aussi, en termes de complémentarité, ce que les Colombiens font ou ne font pas. C'était donc assez décevant, en fait. Le Yémen est toujours en attente, ainsi que la Libye, qui fait partie de l'enquête [de la CPI]. Et l'Afghanistan en est là où il en est. Le bilan est donc mitigé.
Quelle est la transparence du processus ?
Ils ont été transparents jusqu'à un certain point, surtout pour le Royaume-Uni et l'Irak, afin que nous comprenions un peu quand et où les décisions seraient prises. Bien sûr, on ne sait pas comment les discussions se sont déroulées en interne, les différentes opinions ou points de vue.
La situation a-t-elle changé avec les différents procureurs ?
Cela change en fonction du procureur en fonction. Sous le mandat de Fatou Bensouda [procureur de la CPI entre 2012 et 2021], la qualité des réunions s'est améliorée au fil des ans. Sous la direction de Karim Khan [procureur de la CPI depuis juin 2021], nous voyons également la direction que prend le Bureau du Procureur, ce qui signifie parfois que nous ne demandons même pas de réunion car la direction que prennent certaines enquêtes a déjà été communiquée publiquement. Comme pour l'Afghanistan, si vous voyez quelle direction a été prise [En septembre 2021, Khan a décidé de ne pas donner la priorité aux enquêtes sur les crimes présumés commis par les forces américaines]. Mais dans d'autres situations où nous classons les communications au niveau opérationnel [avec les enquêteurs/analystes réels - les personnes qui travaillent directement sur la situation], cela continue comme avant.
Comment cela se compare-t-il à votre expérience au niveau national ?
Dans tous les systèmes nationaux, il peut y avoir des plaintes pénales ou des communications qui ne font qu'une seule fois la une des journaux et dont on n'entend plus jamais parler. Il y a aussi celles qui font partie d'une stratégie de plaidoyer. Et puis il y a celles qui sont des plaintes légales qui offrent des preuves sur la façon d'y arriver, qui comprennent comment le procureur et les enquêteurs travaillent et leur facilitent la tâche ou, au moins, leur donnent quelques pistes sur ce qu'il faut faire avec cette communication. C'est toujours notre approche, à la CPI ou au niveau national, de déposer non seulement en tant qu'ONG mais aussi en tant qu'avocats. Il s'agit essentiellement de dossiers où nous avons mené nos propres enquêtes et où nous savons quels experts ont parlé de la situation, où il peut y avoir des témoins dans des conditions stables, représentés par un avocat, de sorte qu'une bonne déclaration écrite [de leur part] peut être obtenue. Les gens aiment les témoins qui relient les crimes à ceux qui les ont décidés.
Si vous voulez sérieusement commencer à monter des dossiers en tant que procureur, vous avez besoin, bien sûr, de preuves. Et lorsque nous déposons un dossier, l'important est de montrer où trouver les preuves et comment les obtenir. Ensuite, avec un peu de chance, l'enquête avance. Nous n'enquêtons pas, je veux dire, nous ne prenons pas de déclarations de témoins, mais nous nous renseignons simplement sur ce dont la personne pourrait témoigner, sur quels crimes, quand, à quel endroit, ce qui s'est passé, [si elle] est en bonne condition pour faire une telle déclaration, si elle n'est pas retraumatisée et ainsi de suite. Nous ne prenons pas de déclaration complète car cela reviendrait à doubler le travail, mais nous montrons essentiellement comment ces preuves peuvent ou doivent être obtenues par les organismes officiels afin qu'ils puissent faire ce travail.
L'analyse juridique est parfois presque secondaire, car le bureau du procureur la fera évidemment lui-même, en fonction des circonstances réelles.
Les unités nationales chargées des crimes de guerre fonctionnent-elles de la même manière que la CPI ?
Nous avons l'expérience d'un certain nombre d'unités chargées des crimes de guerre en Europe et à la CPI, et chacune est différente. Elles sont régies par des lois et des pratiques différentes. Elles se ressemblent de plus en plus, car il y a davantage de personnes, par exemple au sein du bureau allemand, qui ont travaillé à La Haye ou dans d'autres tribunaux internationaux et qui font des allers-retours. C'est une grande évolution des 10 ou 20 dernières années, le système est plus interchangeable. Mais bien sûr, les règles et la culture sont différentes et chaque bureau a ses avantages et ses inconvénients. Avec le Bureau du Procureur de la CPI, il a été plus facile de se rencontrer au niveau professionnel. C'est plus difficile pour les unités chargées des crimes de guerre au niveau national, car leur code de procédure pénale est plus strict. Ils rencontrent les avocats des victimes parce que c'est leur droit selon la loi, mais avec les ONG, ils n'ont pas le droit de faire partie d'une enquête et les procureurs doivent être prudents.


Andreas Schüller, avocat allemand, est directeur du Programme sur les crimes internationaux et sur la responsabilité, au Centre européen des droits constitutionnels et humains (ECCHR), basé à Berlin, qu’il a rejoint en 2009. Il travaille sur la torture et les attaques de drones par les États-Unis, les actes de torture par le Royaume-Uni en Irak, les crimes de guerre au Sri Lanka et en Syrie, ainsi que d'autres cas de crimes internationaux.