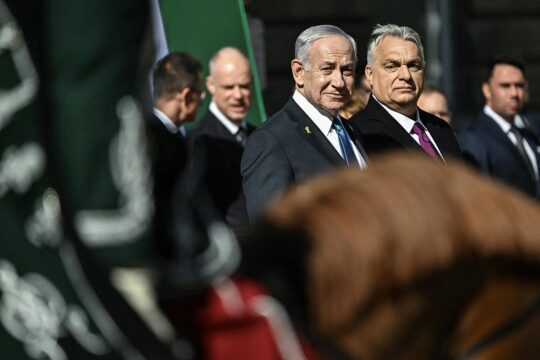Chaque année, un thème dominant se dégage des débats organisés par les ONG en marge de l’assemblée des États membres de la Cour pénale internationale (CPI). Cette année, vous auriez pu parier sur la Palestine et vous auriez perdu : parmi la quarantaine de panels de discussions au programme, aucun n’annonçait ce sujet. L’attaque du Hamas en Israël, le 7 octobre, et la destruction de Gaza par l’armée israélienne sont intervenues trop tard dans la préparation de l’assemblée qui se tenait du 4 au 14 décembre, à New-York, au siège des Nations unies. Vous auriez pu voter pour l’Ukraine, où les crimes de guerre continuent de s’empiler et où le bureau du procureur a sa plus grande représentation en dehors du siège, à La Haye. Mais le conflit qui occupait tous les esprits il y a un an n’est (déjà) plus l’obsession du moment, malgré le mandat d’arrêt lancé en mars contre le président russe Vladimir Poutine.
L’écocide et la menace environnementale avaient été en vogue en 2019, avant deux années d’assemblée plénière anesthésiées par la pandémie de Covid-19. Quant à l’autre question au-devant de la scène en 2022, le projet de création d’un tribunal spécial sur le crime d’agression de l’Ukraine par la Russie, elle a perdu du souffle. Les vents ne lui sont plus très favorables.
Les discussions sont « compliquées, techniques et n’ont pas abouti à un consensus », reconnaît un diplomate qui travaille sur le crime d’agression au niveau des Nations unies depuis vingt ans, le Liechtensteinois Christian Wenaweser, ancien président de l’Assemblée des États parties à la CPI de 2008 à 2011. Il précise que « le problème n’est pas juridique, c’est une question de volonté politique ». Combien d’États manquent à l’appel pour que l’Assemblée générale de l’Onu vote la création d’un tel tribunal qui viserait les plus hauts dirigeants de la Fédération de Russie ? On ne le sait pas, confie-t-il à l’issue d’un débat organisé en marge de l’assemblée. Une résolution a été rédigée mais elle n’a jamais été soumise aux États, l’Ukraine craignant son échec. Wenaweser veut croire que les circonstances peuvent changer et le projet rebondir. Mais il est clair, à ses yeux, que seul un tribunal créé au niveau de l’Onu aurait la légitimité suffisante (sans parler de l’obstacle, relevé par d’autres, des immunités diplomatiques). Il n’y a pas de « plan B », comme un tribunal établi sous l’égide du Conseil de l’Europe. En attendant, l’Ukraine pourrait au moins décider de rejoindre la CPI en tant qu’État partie. « Le message politique serait énorme pour nous », insiste Wenaweser en se tournant vers un représentant de l’Ukraine.
Deux poids, deux mesures
Et ce sont à nouveau les « petits » États qui, comme lors de la création de la CPI en 1998, promeuvent l’application du droit. « Pour nous, le respect du droit international est notre pain quotidien. C’est une question d’intérêt et de survie », constate Wenaweser. Mais l’heure n’est pas à la paix entre les puissances. « Nous faisons face à [un contexte] où les États pensent que l’usage de la force est une façon de régler les problèmes », constate le diplomate. Ce sont les petits pays qui poussent l’agenda du droit mais ce sont les grands qui décident, en fonction de leurs intérêts.
Dans l’ombre du débat sur le crime d’agression, se trouve la question du « deux poids, deux mesures » dont la justice internationale est accusée depuis longtemps et qui est redevenue vive depuis les guerres en Ukraine et à Gaza. Si l’on veut juger la Russie pour l’agression de l’Ukraine, pourquoi ne pas l’avoir fait pour l’invasion de l’Irak par les États-Unis en 2003 ? Pourquoi tant de soutiens occidentaux pour la justice en Ukraine et si peu d’empressement en Palestine ? L’Occident est partout rattrapé par son passé, ses partis pris et son hypocrisie.
« Dans le monde où j’agis, celui de la justice internationale, le deux poids deux mesures est l’obstacle le plus important. C’est le point de friction principal. La justice internationale est toujours tombée à plat quand il s’agit de s’affronter aux puissants intérêts occidentaux », souligne Reed Brody sur la chaîne Democracy Now!, juste après la visite du procureur de la CPI Karim Khan en Israël et en Cisjordanie, à la veille du rendez-vous de la Cour à New-York.
Cet avocat des droits humains américain, ancien pilier de l’organisation Human Rights Watch, a été moteur dans le procès de l’ancien dictateur tchadien, Hissène Habré. Mais il aurait tout autant aimé que Henry Kissinger ou George W. Bush soient jugés. « Depuis quinze ans, les plaintes palestiniennes devant la CPI ont été traitées au pas de sénateur par les trois procureurs. Luis Moreno Ocampo a passé plusieurs années à évaluer si la Palestine était ou non un État. Les amis de la CPI ont fait pression sur les autorités palestiniennes pour qu'elles ne ratifient pas le traité [de Rome, qui consacre l’adhésion d’un État à la Cour]. La deuxième procureure, Fatou Bensouda, a passé cinq ans à vérifier si des crimes avaient été commis pour finalement conclure, alors qu'elle était sur le point de quitter ses fonctions, qu'il y avait suffisamment de preuves pour croire que des crimes avaient été commis, dont les colonies [israéliennes] illégales et des crimes de guerre des deux côtés. Le procureur Karim Khan a eu cette question sur son bureau pendant deux ans. Il n'y avait qu'une seule personne pour enquêter dessus », dénonce-t-il. « Les colonies israéliennes sont des crimes de guerre. Il n'est même pas nécessaire d'aller sur le terrain pour enquêter sur ces crimes. », affirme Brody.

La Palestine, miroir des hypocrisies
Les coulisses d’une assemblée plénière de la CPI sont une sorte de grande foire feutrée et policée de la justice internationale. Un grand rassemblement où les ONG promeuvent leurs actions, poussent leurs agendas auprès des États membres et auprès du bureau du procureur. Il s’y joue inévitablement une forme de concurrence des victimes, par représentants directs ou militants interposés. Mais les seuls Israéliens que l’on pouvait croiser étaient ceux venus pour les débats dans les enceintes politiques de l’Onu, l’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité, pas pour la CPI (dont Israël n’est pas membre). Aucun d’entre eux n’était là pour défendre leurs positions et intérêts dans les sous-sols étouffants où l’activité des ONG avait été confinée. Et c’est la voix de la Palestine, désespérée et exaspérée, meurtrie et déterminée, qui est le plus souvent venue déranger le confort de l’entre-soi de la justice internationale à New-York. La Palestine n’était officiellement pas à l’agenda mais elle s’est invitée et était dans tous les esprits et les discussions de couloir. Elle a collé aux chaussures de Khan comme un sparadrap dans les panels où il s’est présenté pour présenter son rapport annuel ou les nouvelles politiques développées par son bureau. Personne ne devait ignorer « l’éléphant dans le salon », comme l’a dit Ahmed Abofoul, juriste de l’organisation palestinienne Al Haq.
L’incohérence et l’hypocrisie n’est pourtant pas l’apanage de l’Occident. Quand un militant d’Afrique du Nord évoque la « coupure entre la CPI et la population arabe, les responsables arabes » et souligne le « défi de deux milliards de musulmans qui nous disent : qu’est-ce que donne la CPI en Palestine ? », il est aisé de lui rétorquer que seuls deux États arabes sont membres de la Cour – la Jordanie et la Tunisie – et qu’aucun des deux n’a signé le référé sur la situation en Palestine envoyé au procureur de la CPI par cinq États, le 17 novembre.
Les blocages du Brésil
L’État qui bloque le plus les débats à la CPI aujourd’hui, y compris pour renforcer les moyens de la cour, est le Brésil. Le budget 2024 de 187 millions d’euros est en augmentation de 10 %, contre une augmentation sollicitée de 16 %. « La position du Brésil est très déconcertante et révélatrice de la politisation de la cour », confie une membre d’une délégation européenne. Le Brésil défend la géopolitique des « BRICS » (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), fer de lance de la contestation de la domination occidentale. Il s’est abstenu lors du vote du rapport de la CPI devant l’Assemblée générale de l’Onu, souhaite supprimer toute référence à la coopération entre la CPI et le Conseil de sécurité de l’Onu et garantir la liberté des États membres de recevoir des personnalités qui feraient l’objet d’un mandat d’arrêt – comme Poutine ou le Soudanais el-Bechir.
Dans le contexte de cette vaste contestation de la domination occidentale, la Palestine est-elle un point de rupture pour la CPI, comme certains l’annoncent ? Quelle place la justice peut-elle avoir quand le droit international humanitaire est remis en cause, ou instrumentalisé, au point que certains experts se demandent si le droit de la guerre existe encore ?
Violences sexuelles, esclavage : les nouvelles frontières
Et finalement, comme s’il fallait un peu oublier l’impotence d’une cour au bilan judiciaire désastreux – 5 condamnations contre des commandants rebelles (tous africains) en plus de vingt ans d’activité, aucune poursuite probante contre des acteurs étatiques – le thème dominant cette année a été les violences sexuelles. 25 ans après le jugement de Jean-Paul Akayesu, qui reconnaissait le viol comme constitutif du génocide des Tutsis du Rwanda, et après de multiples jugements rendus par les tribunaux internationaux, on pouvait se demander ce qui explique cette mobilisation autour des crimes sexuels : plus personne ne s’interroge sur le viol comme crime de guerre ou comme crime contre l’humanité.
Mais pour les militants du droit, il est temps d’avoir un débat nettement plus sophistiqué sur la question. Ce qui doit désormais s’imposer, c’est la reconnaissance de la variété des crimes basés sur une discrimination par le genre. « Presque chaque crime du Statut de Rome [le traité qui fonde la CPI] peut être genré », explique Kim Thuy Seelinger, conseillère auprès du procureur pour les violences de genre. En somme, la compréhension de ces violences suit un mouvement comparable à celui qui a marqué le féminisme. Elles doivent désormais être comprises comme allant bien au-delà des crimes à caractère strictement sexuel, y compris des formes « d’apartheid » envers les femmes comme en Afghanistan ou en Iran. Et elles touchent aussi les hommes – présents parmi les victimes invitées – et les LGBTQ.
Un même effort d’approfondissement a transpiré du débat sur la « décolonisation » du droit international. Pour Patricia Viseur-Sellers, conseillère du procureur pour les crimes d’esclavage, il convient d’amender le Statut de Rome pour que cette réalité contemporaine soit mieux comprise dans les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Enfants soldats, « bush wives », migrants, Yezidis… Le commerce esclavagiste est une réalité contemporaine. Il existe également un « lien entre race, esclavage, colonialisme et changement climatique », avance Priya Morley, professeure à la faculté de droit de l’université de Californie. Les peuples autochtones sont particulièrement affectés. « La crise écologique mondiale est une injustice raciale mondiale. »
Le grand flou de la complémentarité
Dans la pratique, la CPI est à la remorque de l’évolution du droit international et des nouveaux enjeux de la violence à grande échelle, notamment hors conflit. Au-delà des discussions sur la réforme de ses statuts, la présence importante d’acteurs de la justice colombienne était éclairante sur le vide de créativité à la CPI. C’est à Bogota et non à La Haye que les cours affirment la dimension culturelle et spirituelle de la destruction des communautés indigènes, qualifient de crime de guerre la destruction du territoire, de l’environnement naturel, de la contamination pétrolière, des héritages culturels.
La CPI, comme tous les tribunaux internationaux de l’après-guerre froide, a une irrépressible tendance à voir sa relation aux justices nationales comme celle d’une institution qui a tout à enseigner et rien à apprendre. La coopération avec les tribunaux nationaux, le principe de complémentarité entre eux et la CPI, ont fait l’objet de plusieurs débats à New-York. Cette complémentarité, théoriquement gouvernée par le règlement de la Cour, n’a jamais été appliquée avec rigueur et cohérence. Et l’impression qui se dégage des tables-rondes est que cette confusion générale, que chacun préfère taire, satisfait tout le monde.
La CPI serait surtout là pour stimuler l’action des justices nationales. « Nous sommes très présents même si nous ne sommes pas toujours visibles », assure Mame Mandiaye Niang, l’un des deux procureurs adjoints. Mais il est difficile de ne pas deviner dans ce discours une façon de masquer un bilan judiciaire famélique et le fait que la Cour n’a produit aucune avancée sur les grands champs contemporains de la violence de masse, comme les crimes environnementaux, la responsabilité des multinationales, le trafic humain, le vol des terres, etc. Et tandis qu’un membre du bureau du procureur se targue de sa relation fructueuse avec la Cour pénale spéciale (CPS), un tribunal hybride en République centrafricaine, Magali Maystre, cheffe de l’unité de soutien de l’Onu à la CPS, l’interpelle : « Le bureau du procureur est-il prêt à apprendre de nous, à établir une coopération à double sens ? »

Une caisse de résonance sans équivalent
En dépit de ces impasses, la CPI demeure cette caisse de résonance unique, que les militants du monde entier investissent pour que l’écho de leurs actions ne reste pas coincé dans la mousson birmane, les sables du Proche Orient ou les montagnes des Andes. C’est le grand paradoxe. Nain judiciaire et politique, la Cour est le refuge symbolique et idéalisé du droit face aux fracas du monde. Aucun des puissants ne la craint, mais presque tout le monde semble vouloir s’en saisir ou influencer ses décisions. « Quand bien même l’idée peut paraître diminuée, nous avons besoin du droit humanitaire international. Nous avons besoin d’une certaine dose de ce droit », confie une juriste qui a accompagné l’émergence de la justice pénale internationale dans les années 1990.
L’écocide ne s’est invité qu’en deuxième semaine, quand beaucoup d’ONG étaient parties. Dans l’immense salle du Conseil de tutelle de l’Onu, il n’y a qu’un peu plus de 20 personnes. A nouveau, l’avenir du droit se joue ailleurs, au niveau national ou au niveau régional. Mais c’est ici que jaillit la voix la plus forte. Celle de Valdelice Veron, qui intervient en vidéo depuis la COP28, qui s’achève à Dubaï. Sur l’écran géant, la porte-parole du peuple Guarani-Kaiowá, dans l’État brésilien du Mato Grosso do Sul, apparaît dans ses habits et sa coiffe traditionnelle, le visage peint. « Qui est derrière cette destruction ? » clame-t-elle, la rage au cœur. L’écocide, dans sa voix, n’est plus l’objet froid d’une définition juridique incertaine. Il n’est plus la seule destruction de la nature par les multinationales et la cupidité des hommes, « au nom du progrès ». Il sonne comme le cri de l’espèce humaine en révolte et en détresse contre la part sombre d’elle-même qui la menace, de Campo Grande à Zaporijia, de Ürümqi à Cox’s Bazar en passant par Al-Fasher.