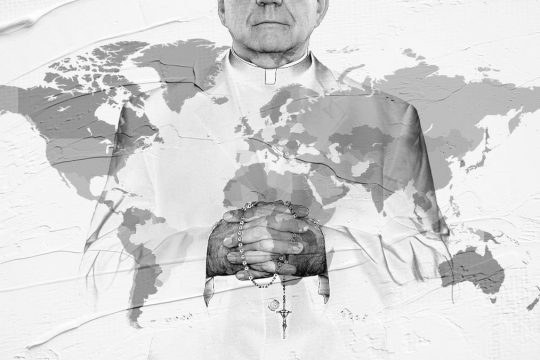JUSTICE INFO : Que sait-on aujourd’hui des violences sexuelles dans l’Église catholique en Afrique ? Quels travaux, recherches, commissions ont permis d’avoir une idée de l’ampleur de ces violences ?
STÉPHANE JOULAIN : Un jour on m’a posé cette question : à quand une CIASE [Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église ayant siégé en France entre février 2019 et octobre 2021] pour l’Afrique ? J’ai répondu que la France est un tout petit pays, qui a entrepris de mener sa commission pour un coût de plusieurs millions d’euros, et l’Afrique un continent de 54 pays. On ne peut pas s’attendre à ce qu’il y ait quelque chose de cet ordre-là, qui demanderait un investissement énorme, inscrit qui plus est dans un continent qui se bat contre la guerre, la malnutrition, la pauvreté endémique et systémique… Lutter contre les violences sexuelles dans l’Église n’est pas la priorité de la plupart des pays africains. Il n’y a pas de données globales concernant les victimes d’agressions sexuelles dans l’Église en Afrique ; on compte plutôt des enquêtes journalistiques sur telle ou telle affaire, mais ce n’est pas à grande échelle. Il y a un manque de données parce que les pays africains sont confrontés au manque de moyens, d’une part, et au manque de volonté d’étudier le phénomène, d’autre part.
Concernant les violences sur les enfants, les gouvernements ont ratifié la Charte des droits de l’enfant. Comme il y a des aides au développement conditionnées au respect des droits de l’enfant, des pays ont fait des efforts sur la question des violences sexuelles dans la société. Là, il existe beaucoup d’études. Mais enquêter à proprement parler sur l’Église est autrement plus difficile pour différentes raisons, la principale étant le poids structurel de l’Église dans les sociétés africaines.
Quels sont les freins pour aborder ce sujet-là ?
Il y a des freins puissants de plusieurs ordres.Tout d’abord, en Afrique, l’Église est perçue comme un centre de pouvoir important, voire de contre-pouvoir politique dans certains pays. Ainsi, dans beaucoup de cultures africaines, les clercs sont des figures communautaires d’autorité intouchables. On ne va pas aller salir l’Église qui soutient les pauvres, les indigents, des hôpitaux… Il y a une pression de la société elle-même sur les victimes et la famille pour ne pas salir le nom de l’institution parce que c’est elle qui défend les droits, par exemple. Dans certains pays d’Afrique où l’Église a une dimension politique, tout ce qui se rapproche d’une médiatisation autour des crimes sexuels concernant des clercs va être considéré comme une attaque politique. Résultat : beaucoup de gens ne disent pas ce qui leur arrive, parce qu’on ne va pas les croire ni les entendre.
Ensuite, dans de nombreux pays, si un homme déclare avoir été agressé sexuellement par un prêtre, c’est très tabou. L’homme serait accusé d’être homosexuel. Or, la morale sexuelle africaine est profondément marquée par une hétérosexualité, un machisme et un « patriarcalisme » forts. Abuser d’un enfant ne correspond pas à cette image. Pour faire simple : cela ne se fait pas. Et de fait, cela engendre un profond déni dans des sociétés entières.
J’ai pu observer que la polymorphie et l’idéalisation de la famille africaine sont des freins au dévoilement. La structure familiale africaine n’est pas la famille mononucléaire à l’européenne, elle est polymorphique, élargie par définition ; la famille comprend les cousins, les oncles, les tantes, etc. « Si ça ne va pas bien un jour chez toi, tu peux aller frapper chez ton cousin ». Très jeune, l’enfant développe l’idée d’appartenance à cette famille étendue – qui, selon les cultures, peut être matrilinéaire ou patrilinéaire - qui devient un filet de sécurité dans des sociétés fragiles. La famille africaine reste le lieu de l’appartenance, on y développe un très grand respect pour la séniorité en apprenant très vite la soumission à l’autorité des adultes. Autrement dit, on ne critique pas les aînés, même quand ils sont abusifs. Donc, cela rajoute des couches de déni.
De plus, la théologie catholique a développé l’idée selon laquelle l’Église d’Afrique est la « famille de Dieu ». Cela veut dire que lorsqu’on est prêtre, les autres doivent se soumettre et ne rien dire. Enfin, je dirais qu’il y a des raisons géopolitiques, avec l’émergence de nouveaux panafricanismes qui impactent la vie religieuse et la vie de l’Église. Je pense aux déclarations du cardinal Ambongo par exemple, à Kinshasa, affirmant que l’homosexualité n’existe pas en Afrique. Quand ce même cardinal de l’Église, conseiller très proche du pape, dit publiquement qu’il partage des valeurs avec Vladimir Poutine [président de la Fédération de Russie], on voit qu’il y a cette volonté de couper de manière radicale les liens coloniaux avec l’Europe.
Vous donnez beaucoup de formations de prévention des abus sexuels auprès des congrégations religieuses sur le continent africain ; sentez-vous que les choses bougent ?
Je constate que la parole s’ouvre tout doucement. Il y a six mois, à Nairobi, j’avais devant moi 125 formateurs. Celles et ceux qui ont pris la parole ont tous dit : « Oui, les abus existent chez nous. » C’est déjà un grand changement de ne plus être dans le déni. Au Kenya, cela pose des difficultés aux prêtres d’aller à la police pour signaler un fait. Je leur explique que le « Sexual Offense Act » et le « Child Protection Act », deux lois au Kenya, incluent une obligation de signalement aux autorités légitimes. Mais ils ont peur. Pourquoi ? Parce qu’aller à la police au Kenya n’est pas forcément la meilleure solution ; on risque de se retrouver soi-même emprisonné parce que l’on a fait un signalement. Chose rare et à noter, récemment un évêque, juriste canonique, à Eldoret (ouest du Kenya) a signalé à la police un de ses prêtres qui aurait abusé d’une fille de 10 ans. La procédure au pénal est en cours. Je constate que, petit à petit, les formations sur la prévention portent leurs fruits.
De son côté, que met en place l’Église en Afrique ?
L’Association des conférences épiscopales membres d’Afrique de l’Est (Amecea) a fait un gros travail de sensibilisation sur la question des victimes. Au Vatican, un élan a été donné pour que les églises du continent africain regardent ces questions-là de près. Par exemple, via la commission pontificale pour la protection des mineurs, un effort est fait pour que les épiscopats s’équipent de politiques de prévention, de protocoles d’intervention et de codes de conduite. Dans la conférence épiscopale du Kenya par exemple, il a été demandé aux évêques kényans de faire leur propre politique diocésaine.
Les pays anglo-saxons s’équipent de plus en plus de ces outils. Dans les pays francophones, c’est un petit peu plus lent. Je suis allé récemment au Burundi avec ma congrégation pour l’Afrique centrale, où nous avons élaboré une politique, des protocoles, des codes de conduite pour la RDC, le Burundi et le Rwanda. Nous allons faire de même pour l’Afrique australe durant l’été 2025 et ensuite pour l’Afrique de l’Ouest, l’année prochaine.
Quand le silence se fissurera, quelle est votre intuition sur l’ampleur des abus sur le continent ?
Concernant les abus sexuels sur les garçons mineurs par des prêtres, on ne sera pas en Afrique sur la même échelle que ce que l’on a pu voir en Europe ou en Amérique du Nord. C’est mon humble avis, au regard de la morale sexuelle dont je vous ai parlé. Ou alors, ce serait le fait de missionnaires européens qui sont venus travailler en Afrique. Ceci n’est pas anecdotique d’ailleurs, et la parole doit s’ouvrir. Par contre, je pense que le vrai sujet concerne les jeunes filles, mineures, adolescentes ainsi que les femmes adultes et les religieuses. Sœur Mary Lembo (religieuse togolaise de la Congrégation des sœurs Sainte Catherine d’Alexandrie, basée à Rome) a fait sa thèse sur les abus de religieuses, un travail très important qui pourrait faire bouger des choses. Ce sujet demande aussi aux sociétés d’évoluer car tant que parler restera une honte pour les victimes, la parole ne pourra pas éclater.

Stéphane Joulain est prêtre catholique, membre de la Société des missionnaires d’Afrique (Pères Blancs). Professeur à l’université Saint-Paul à Ottawa (Canada) il est aujourd’hui directeur clinique du Bethany Center for Counseling and Spiritual Renewal au Kenya. Il a publié : Combattre l’abus sexuel des enfants (Desclée de Brouwer, 2018) et L’Église déchirée. Comprendre et traverser la crise des agressions sexuelles sur les mineurs (Bayard, 2021). Psychothérapeute, il enseigne à Rome et dans des pays africains sur la prévention des abus sexuels.