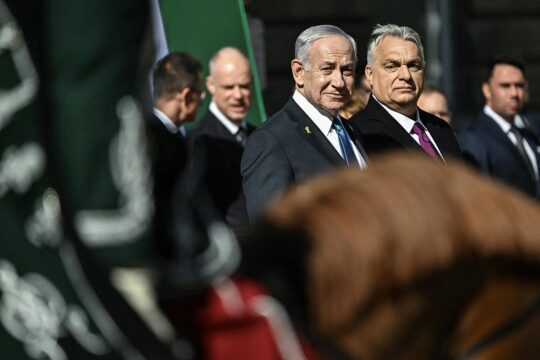A l’ouverture de la XVème Assemblée des Etats parties à la Cour, le 16 novembre, la fronde d’une partie des Etats africains semble, au moins provisoirement, circonscrite. Le départ, mi-octobre, du Burundi, de l’Afrique du Sud et de la Gambie - qui affirment qu’ils ne reviendront pas sur leur décision – est utilisé par d’autres comme un ultime avertissement à la CPI. Au premier jour des débats, la Russie a annoncé retirer sa signature du traité fondateur de la Cour, plombant un peu plus une atmosphère déjà tendue.
Si les frondeurs africains ont accepté le dialogue proposé, ils ne donnent pas, loin s’en faut, un blanc-seing à la CPI. Il y a « un statu quo et beaucoup de frustrations », analyse un diplomate européen après les trois premiers jours de débats devant l’Assemblée des 124 Etats membres de la Cour réunis à La Haye. Le Burundi, l’Afrique du Sud et la Gambie se sont retirés du traité de la juridiction mi-octobre, mais ont fait le voyage de La Haye. Leur départ ne sera effectif que dans un an. Comme pour plomber l’ouverture des débats, Moscou a annoncé le retrait de sa signature du traité de la Cour. La Russie ne l’a pas ratifié, mais éloigne toute possibilité de la faire et s’offre ainsi la possibilité de la contrer, alors que la procureure a ouvert en février une enquête sur les crimes commis lors de la guerre éclair de l’été 2008 en Géorgie. L’annonce de Moscou, au premier jour des débats, n’a pas empêché les Etats d’accepter le « dialogue » proposé. Mais l’Afrique du Sud assure qu’elle ne reviendra pas. A la tribune, le ministre de la justice Michael Masutha, promet néanmoins que son pays « ne deviendra pas un havre de paix pour les fugitifs » et réformera ses procédures internes en ce sens. Puis précise que le retrait ne mettra pas un point final à sa coopération avec la Cour. Contrairement au Burundi, dont l’ambassadrice assure sans réserve s’être retirée du traité de Rome « au nom du peuple » burundais, tandis que Bujumbura s’isole de tous les mécanismes internationaux pour tranquillement réprimer sa population. L’Afrique du Sud ne soutient pas l’impunité, mais espérait une autre Cour.
L’audience de juin 2015
Son ministre de la Justice revient sur l’origine de sa défection : la visite d’Omar El Béchir en juin 2015. Le soudanais, contre lequel pèse deux mandats d’arrêt de la Cour, comptait parmi les invités d’un sommet de l’Union africaine, mais avait pu tranquillement rejoindre Khartoum sans être inquiété, malgré la décision d’un tribunal sud-africain. Or peu avant, Pretoria consultait la Cour, comme le permet l’article 97 de son Statut. Alors que le conseiller juridique du ministère de la Justice sud-africain était en route pour La Haye, son ambassadeur rencontrait le greffier, Herman von Hebel, pour organiser la logistique de la rencontre mais se retrouvait devant un juge de la Cour, en audience. « L’Afrique du Sud voyait ces consultations comme étant de nature diplomatique et non judiciaire », explique à la tribune de l’Assemblée le ministre Michael Masutha. Suite à cet épisode, Pretoria avait demandé à la dernière assemblée de préciser les dispositions de l’article 97, mais sans succès. A l’époque, l’Afrique du Sud espérait aussi, comme d’autres, l’amendement de deux articles, que beaucoup jugent contradictoires. L’article 27 ôtant aux chefs d’Etat leur immunité. Et l’article 98, stipulant qu’un Etat ne peut exécuter une demande de la Cour le contraignant à agir en contradiction avec ses obligations en matière d’immunité diplomatique. C’est sur ces points précis que nombre d’Etats regrettent l’absence de dialogue. Mais pour d’autres, rouvrir la question de l’immunité des chefs d’Etats en exercice reviendrait à s’attaquer au cœur du traité de Rome. Décider de ne poursuivre les chefs d’Etat « qu’une fois qu’ils auront quitté le pouvoir les entrainera à s’accrocher au pouvoir à vie, et conduirait des chefs de milices à convoiter la place », explique Richard Dicker, de Human Rights Watch.
L’affaire El Béchir embarrasse aussi l’Ouganda. Sommée de s’expliquer suite à l’invitation du président soudanais à Kampala en février, pour l’intronisation de Yoweri Museveni, fraichement réélu, l’Ouganda regrette une récente décision des juges l’accusant d’avoir violé ses obligations vis-à-vis de la Cour. « Ce n’est pas différent de l’invitation faite à Omar El Béchir par le Secrétaire général des Nations unies », pour la conférence de la CPI à Kampala, en juin 2010, rappelle le procureur général de l’Ouganda, William Byaruhanga, qui appelle surtout à trouver « un juste équilibre » entre la paix et la justice. Pour le reste, l’Ouganda, qui comptait parmi les plus virulents pourfendeurs de la Cour et menaçait de s’en retirer lui apporte désormais un ferme soutien.
La colère des chefs d’Etat africains remonte à l’année 2008 et l’annonce, par le procureur, de mandats d’arrêt à venir contre le président du Soudan. Khartoum n’a pas ratifié le traité de la Cour, et seul le Conseil de sécurité de l’Onu pouvait la saisir des crimes commis dans le pays. Suite aux deux mandats d’arrêt délivrés par les juges, l’Union africaine avait, à plusieurs reprises, suscité ce même Conseil, lui demandant de suspendre les procédures, comme il peut légalement le faire lorsqu’une affaire entrave la paix et la sécurité internationale. « C’est devant cette Assemblée que nous devons débattre des questions judiciaires, politiques et diplomatiques », rappelle sans relâche le patron de l’Assemblée, le ministre de la Justice du Sénégal, Sidiki Kaba. Or certaines questions ne peuvent se traiter qu’à New York.
Les pouvoirs des privilégiés du Conseil de sécurité
Là où, comme le dénoncent avec force le Ghana et la Namibie, des Etats qui n’ont pas ratifié le traité de la Cour – Etats-Unis, Chine et Russie – peuvent néanmoins décider de la saisir, ou au contraire, s’opposer à son intervention, comme l’a fait la Russie pour les crimes en Syrie. Damas n’est pas membre de la Cour, et seul le Conseil de sécurité peut donc la saisir. Mais Moscou avait apposé son véto à une telle résolution. Alors l’ambassadeur du Ghana fustige « les champions des droits de l’homme », ceux qui disposent d’un véto au Conseil de sécurité, des « privilégiés », qui « non seulement préservent leurs protégés », mais « ont utilisé le droit international pour servir leur pouvoir hégémonique ». Tony Aidoo compte sur le jugement de la postérité. L’histoire retiendra « que ce ne sont pas les bombes africaines qui créent la crise humanitaire en Libye, en Syrie, en Irak, au Moyen-Orient, en Afghanistan et au Pakistan », dit-il. Pour la Namibie aussi, le droit de veto est un passeport pour l’impunité. Le président de l’Assemblée partage ces inquiétudes et juge qu’il faut réformer « le système actuel issu de Yalta ». Pour le Sénégalais Sidiki Kaba, « le droit de véto n’est pas un privilège, mais une lourde responsabilité, il doit être encadré pour les crimes de masse ».
L’arrivée de Donald Trump au pouvoir et l’opposition désormais ouverte de la Russie à la CPI, éloigne sans doute pour longtemps toute saisine de la Cour par New York.
Cibler l’Afrique ?
Même ses plus vibrants supporters, comme le Botswana, la Sierra Leone et le géant Nigérian, jugent injuste de voir l’Afrique sans cesse placée au rang des mauvais élèves de la classe planétaire. Et le fait que les mandats d’arrêt délivrés jusqu’ici par la Cour ne ciblent que les responsables du continent, alourdi forcément le trait. Les frondeurs laisseront-ils le temps à la Cour de réajuster sa politique pénale ? Fatou Bensouda a ouvert début janvier une enquête sur la Géorgie. Elle pourrait, dans les prochaines semaines, le faire sur l’Afghanistan. La Namibie semble prête à attendre et voir. Windhoek, qui depuis la dernière assemblée annonce un départ imminent, n’a pas encore fait ses valises, dit en substance son ministre de la Justice. La question d’un éventuel retrait de la Cour sera posée à son parlement. En attendant, Issaskar Ndjoze a salué le dernier rapport de la procureure sur les examens préliminaires.
Fatou Bensouda y détaille ses dernières analyses sur les crimes commis dans cinq pays hors du continent africain. Elle y évoque aussi la possibilité d’ouvrir une enquête pour les prisons secrètes de la CIA en Europe et a demandé à la Pologne, la Lituanie et la Roumanie si des enquêtes étaient en cours dans leur pays. Mais le Kenya semble peu sensible à l’argument. L’affaire engagée par la Cour sur les crimes commis en 2010 dans son pays n’est pas totalement close et Nairobi attaque, demande des réformes, laisse planer le doute sur un éventuel retrait.
La tonalité des débats
Cette Assemblée « n'a pas le monopole de la promotion et de la protection des droits de l'homme ni de la lutte contre l'impunité malgré les affirmations contraires », assure Rose Makena Muchiri, l’ambassadrice du Kenya. Comme le Ghana et l’Ouganda, le Kenya regrette la tonalité des débats et fustige le Haut-commissaire aux droits de l’homme de l’Onu, le prince Zeid Al Hussein, qui à l’ouverture de l’Assemblée a lancé un virulent « qu’ils partent ! ». La menace des départs plane depuis 2013 sur la Cour et l’affaire Kenyatta. Comme le haut-commissaire, certains diplomates et ONG ne souhaitent pas que l’Assemblée soit de nouveau prise en otage. « Les États parties ont été accusés de déserter les victimes de crimes internationaux tout en se faisant passer pour les défenseurs des droits de l'homme », regrette Rose Makena Muchiri, qualifiant de « tristes et tragiques ces accusations », alors que « l’Afrique continue d’accueillir des millions de réfugiés que d’autres qualifient d’immigrants illégaux ». S’il est un Etat qui craint l’effondrement de la Cour, s’est bien la Palestine. Mais à la tribune, son ministre des Affaires étrangères, Ryad Al Malki, a demandé à la procureure d’accélérer l’ouverture d’une enquête, sans voiler sa déception. Cette Assemblée est « un menuet dans un monde de Heavy metal ! », commente un avocat. Pendant que les débats se poursuivent à La Haye, Alep et Mossoul continuent de compter leurs morts.