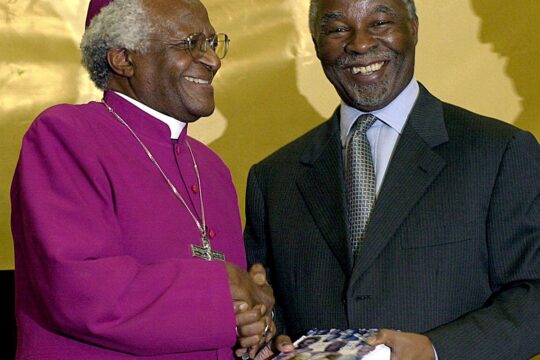L’Afrique du Sud sera devant la Cour pénale internationale (CPI) vendredi 7 avril. Les juges devront décider si Pretoria a violé son obligation de coopérer en refusant d’arrêter le président soudanais, Omar Al Bachir, lors de sa visite pour un sommet de l’Union africaine en juin 2015. L’occasion pour la Cour, dont la décision sera rendue plus tard, de se prononcer enfin clairement sur les multiples questions soulevées par cette affaire depuis l’émission du premier mandat d’arrêt pour crimes contre l’humanité contre le chef de l’Etat soudanais, en mars 2009.
Le 29 mars 2017, Omar Al Bachir, invité du sommet de la Ligue arabe, posait ses valises à Amman. La Jordanie, partie à la Cour pénale internationale (CPI), n’exécutait pas les mandats d’arrêt émis contre le président soudanais pour génocide et crimes contre l’humanité, mais répondait néanmoins, confidentiellement, aux requêtes de La Haye. Avant elle, le Tchad, la République démocratique du Congo (RDC), l’Ouganda, Djibouti et d’autres, s’étaient aussi usés à l’exercice. Pour la Cour, les sauts de puce du soudanais sur le territoire de ses Etats membres, donnent lieu à une sempiternelle procédure : requête du procureur signalant un futur déplacement, signification des mandats d’arrêt par la Cour à l’Etat d’accueil de l’encombrant visiteur, réponse de l’hôte puis éventuellement, décision actant la non coopération et renvoyant la question aux instances diplomatiques. L’audience du 7 avril, à laquelle l’Afrique du Sud se prépare depuis de longues semaines changera-t-elle la donne ? La Cour devra décider si Pretoria « n’a pas respecté ses obligations » vis-à-vis de la Cour en refusant d’arrêter Omar Al Bachir lors de sa visite de juin 2015. Et s’ils devaient constater que l’Afrique du Sud a failli, les juges pourraient signifier cette non-coopération à l’Assemblée des Etats parties ou au Conseil de sécurité des Nations unies, voire aux deux.
Le retrait sud-Africain jugé invalide
Presque deux ans se sont écoulés depuis l’épisode, rocambolesque, du départ « en catimini » d’Omar Al Bachir vers Khartoum. Le 14 juin 2015, alors qu’il posait sur la photo des dirigeants africains invités du sommet, le Southern Africa Litigation Center (SALC), une organisation non gouvernementale, saisissait la Haute Cour de Pretoria. Les juges demandaient au gouvernement d’empêcher Omar Al Bachir de quitter le territoire, le temps de se prononcer sur le fond. Le lendemain, ils ordonnaient son arrestation. Mais le suspect est alors déjà en vol pour Khartoum, tandis que le gouvernement sud-africain, qui a foulé au pied la décision de ses propres juges, suscite la condamnation unanime d’ONG de défense des droits de l’homme, de juristes et de l’opposition au président Jacob Zuma. S’enclenche de longues procédures devant des juges sud-africains, dont le gouvernement sortira perdant à l’automne 2016. Le 19 octobre, l’Afrique du Sud renonce à son dernier recours et annonce dans la foulée son retrait du traité de la Cour pénale internationale, entrainant le Burundi et la Gambie dans son sillage. Banjul tournera de nouveau casaque après l’élection d’Adama Barrow à la présidence en décembre 2016. Quant au gouvernement sud-africain, il est contraint de renoncer, au moins provisoirement, à son retrait de la Cour et l’annonce le 8 mars, après que des juges aient déclaré « inconstitutionnelle et invalide » la décision du retrait, prise sans l’aval de son parlement.
L’immunité d’Omar Al Bachir
Quinze jours avant l’arrivée d’Omar Al Bachir en Afrique du Sud en juin 2015, la Cour avait demandé aux autorités d’exécuter les mandats d’arrêt délivrés contre lui. A l’époque, Pretoria avait établi, en tant qu’Etat hôte, un accord assurant aux délégations invitées leurs immunités. Puis L’Afrique du Sud avait décidé de consulter la Cour, comme le permet l’article 97 de son Statut. Le 12 juin 2015, l’ambassadeur d’Afrique du Sud aux Pays-Bas se retrouvait en audience face au procureur. Dans l’esprit de l’Afrique du Sud, la consultation était « diplomatique et politique » et non pas quasi-judiciaire, explique aujourd’hui Pretoria, qui, non sans ironie, souligne que les entretiens diplomatiques avec la Cour sont une pratique constante. Dans son mémoire, l’Afrique du Sud explique que selon l’article 98-2 du Statut de la Cour, aucun Etat ne peut être contraint d’agir de façon incompatible avec ses obligations internationales en matière d’immunité, à moins d’obtenir la coopération de cet Etat ou son consentement. De son côté, la procureure reconnait, dans son mémoire, la difficulté à laquelle faisait face l’Afrique du Sud, elle lui reproche néanmoins d’avoir « mis en place les conditions légales de sa non coopération. » L’article 98-2 « n'était clairement pas destiné à s'appliquer aux situations où un État partie décide de mettre en place un accord pour ne pas exécuter des demandes spécifiques d'arrestation et de livraison. Une telle interprétation porterait atteinte à l'objet et au but du Statut », rétorque donc la procureure. Mais « en l’absence d’une renonciation expresse du Soudan concernant les immunités d’Omar Al Bachir », l’Afrique du Sud ne pouvait pas l’arrêter et le livrer à la Cour, estiment les avocats sud-africains. Si pour le procureur, il appartenait à Pretoria d’obtenir cette levée d’immunité de la part du Soudan, pour l’Afrique du Sud, la question est au contraire du seul ressort de Khartoum, de la Cour et des Nations unies.
Les ambigüités de la résolution 1593
Jusqu’ici, la Cour a toujours estimé que la résolution 1593 de mars 2005 - par laquelle le Conseil de sécurité des Nations unies avait saisi la Cour des crimes commis au Darfour - lève toute ambigüité. Elle oblige le Soudan à coopérer et lèverait donc de facto toute question d’immunité. Mais le Conseil de sécurité n’a pas pouvoir de lever les immunités, maintient l’Afrique du Sud dans son mémoire. Si tel était le cas, la résolution 1593 l’aurait expressément signifié, plaident ses avocats qui ajoute que lorsqu’une résolution des Nations unies dévie les règles générales du droit international, elle le dit explicitement. Pour appuyer sa thèse, Pretoria souligne que, dans cette même résolution, « la compétence de la Cour envers les ressortissants de certains Etats est évincée ».
Le droit sud-africain
Si le Statut de la Cour ne reconnait aucune immunité aux auteurs de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, cette immunité existe toujours devant les justices nationales, rappelle l’Afrique du Sud. Et d’ajouter que si la ratification du traité de la Cour implique l’abandon des immunités des dirigeants, elle ne peut pas ôter les immunités du président soudanais dont le pays n’a pas ratifié le traité. Mais pour le South Africa Litigation Center, dont les avocats seront eux aussi présents lors de l’audience de vendredi, le droit sud-africain obligeait le gouvernement à arrêter le suspect soudanais. La constitution sud-africaine invite les juges à favoriser, en cas d’obligations contradictoires, les décisions les plus en accord avec le droit international. Et la loi interne de mise en œuvre du Statut de la Cour est sans ambigüités : les demandes d’arrestation émanant de la Cour doivent être exécutées assure le SALC. C’est ce que conclura aussi la Cour suprême. C’est d’ailleurs sur cette base que l’Afrique du Sud avait elle-même signifiée à plusieurs reprises au président soudanais qu’il serait arrêté s’il se présentait sur son sol, que ce soit pour l’intronisation de Jacob Zuma, la coupe du monde de football ou l’enterrement de Nelson Mandela.
Les preuves que l’Afrique du Sud a bafoué ses obligations
Le South Africa Litigation Centre, qui reproche au gouvernement d’avoir « activement facilité la fuite » d’Omar Al Bachir, demande donc à la Cour d’exiger du gouvernement sud-africain tous les rapports d’enquête rédigés suite à cette affaire. Les preuves indiquent que « l’Afrique du Sud a activement bafoué son obligation et cela pourrait avoir peu de conséquences sur le plan intérieur », estime l’organisation, qui demande donc à la Cour de référer l’Afrique du Sud au Conseil de sécurité de l’Onu. La procureure, de son côté, estime qu’elle doit aussi être référée à l’Assemblée des Etats parties. Fatou Bensouda estime en outre que les juges n’ont pas à se pencher sur la question du conflit ente différentes obligations juridiques, et encore moins sur l’immunité de Bachir, puisqu’ils ont depuis longtemps décidés. Et puisque les dommages sont faits, pensons au futur suggère la procureure, qui rappelle que référer l’affaire à ces deux instances « est le seul mécanisme judiciaire dont dispose la chambre pour remplir le mandat donné » par le Conseil de sécurité de l’Onu. Les occasions manquées auront laissé au bureau du procureur le temps de fournir son dossier contre le suspect Omar Al Bachir. Un dossier ouvert par le précédent procureur, Luis Moreno Ocampo, qui a échoué dans de nombreuses d’affaires, fautes de preuves solides. L’accusation consacre cette année à l’enquête Darfour un budget de quelques 3 millions d’euros.
L’Onu aux abonnés absents
Invitées à participer à l’audience de vendredi, les Nations unies ont préféré décliner. C’est pourtant le Conseil de sécurité de l’Onu qui avait saisi la Cour des crimes commis au Darfour en mars 2005. C’est aux Nations unies qu’à plusieurs reprises, la Cour a signalé les défauts de coopération de plusieurs Etats. Et tout au long de l’affaire, des divergences vives sur l’interprétation de la résolution 1593 sont apparues. Dans son mémoire adressé aux juges mi-mars, l’Afrique du Sud suggère même de faire intervenir la Cour internationale de Justice (CIJ). Cette Cour de l’Onu pourrait donner un avis juridique sur l’interprétation de certains articles du traité fondateur de la Cour et de la résolution la saisissant.