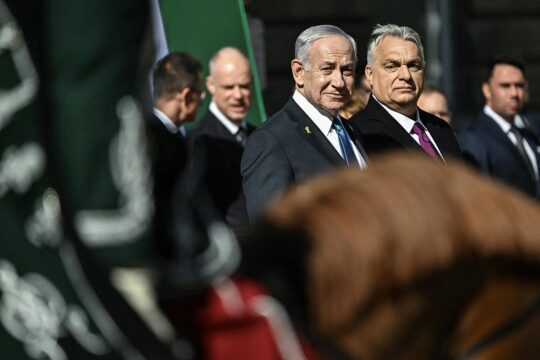Exsangue, la Centrafrique continue d’essuyer les violences des milices et tente de se reconstruire après la guerre civile de 2012-2014, qui a fait plus de 5000 morts et provoqué la fuite de près de 900 000 centrafricains, aujourd’hui réfugiés ou déplacés. Dans un pays ou le pouvoir en place ne contrôle qu’une partie de son territoire, la justice tente de se frayer un chemin. La Cour spéciale centrafricaine, créée en 2015 et basée à Bangui, vient de désigner son procureur et plusieurs magistrats, tandis que la Cour pénale internationale enquête depuis 2014 sur les crimes de la dernière guerre.
« L’atteinte portée aux soldats de la paix de la Minusca constitue des crimes graves », a déclaré le président de la Centrafrique au lendemain de l’attaque, le 14 mai, d’une base de la Mission des Nations unis (Minusca) à Bangassou, dans le sud-est du pays. Réagissant à ces nouvelles violences, dont le bilan provisoire s’élève à six morts dans les rangs des casques bleus et au moins 30 du côté des civils, Faustin Archange Touadéra a promis que les auteurs de ces crimes « répondront devant les juridictions nationales et internationales ». Depuis 2015, la Centrafrique dispose de trois systèmes de juridictions pour poursuivre les auteurs de crimes de guerre et crimes contre l’humanité. En 2014, au plus fort des combats opposant milices Séléka et anti-balaka, la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, avait demandé à la Cour pénale internationale (CPI) d’intervenir. Pour l’instant, et après presque trois ans d’enquête, aucun suspect n’a encore rejoint la prison de La Haye. Mais parallèlement à l’action de la CPI, le gouvernement de transition à Bangui décidait, au printemps 2015, de créer une Cour pénale spéciale (CPS), établit en accord avec l’Onu. Elle se met lentement en place. En attendant, les juridictions régulières doivent, elles, traiter les nombreux dossiers visant des miliciens incarcérés, mais manquent cruellement de moyens humains et financiers. « Dans l’ensemble, et compte tenu du bourbier centrafricain, cela avance », estime néanmoins Florent Geel, responsable Afrique à la Fédération internationale des Ligues des droits de l’Homme (FIDH). En février, le colonel congolais (RDC), Toussaint Mutazini Mukimapa, est devenu procureur de la CPS, qui sera composée de magistrats centrafricains et internationaux. Plusieurs ont déjà été nommés. Des experts planchent actuellement sur le futur code de procédure pénal, bientôt fin prêt, et qui permettra de juger les auteurs de crimes commis depuis 2003 en Centrafrique. Enfin, la Minusca et le PNUD devraient bientôt boucler leur « mapping », un inventaire détaillé des crimes commis dans le pays et qui servira de base au nouveau procureur.
A quoi sert la CPI ?
Dans ce paysage inédit, le rôle de la CPI apparait à certains redondant. « A quoi sert la CPI s’il faut créer une juridiction hybride pour la complémenter ? C’est une question qui revenait souvent pendant les négociations sur la loi créant la CPS » se rappelle Patryk Labuda, de l’Académie de droit international humanitaire et des droits humains de Genève. Soutenue par la France et les Etats-Unis, le projet n’était pas acquis d’office. « Au début, l’Onu ne voulait pas de la Cour spéciale centrafricaine », se rappelle Florent Geel. De son côté, l’Union européenne, dont les membres financent déjà une large partie du budget de la CPI, a longtemps trainé des pieds, préférant se concentrer en priorité sur la reconstruction des institutions judiciaires et la formation de policiers et magistrats. Mais pour Florent Geel, la CPI, comme la CPS, a toute sa place dans ce paysage judiciaire et les différentes initiatives permettent « le rétablissement d’une chaine juridique complémentaire ». Du côté de la Cour, le bureau du procureur estime que « les différents systèmes » de justice « ne sont pas exclusifs, mais sont plutôt complémentaires ». « Aucun système unique ne peut traiter toutes les affaires », ajoute-t-on, rappelant que la CPI est intervenue à la demande de la présidente d’alors, Catherine Samba-Panza. Mais pour Patryk Labuda, la Cour spéciale reflète, par certains aspects, « un échec de l’intervention décennale de la CPI dans le pays et met en évidence les lacunes de la communauté internationale pour combattre l’impunité en Afrique ». Il y a dix ans, la CPI a conduit une première enquête portant sur les crimes commis lors de la guerre de 2002/2003, se soldant par la victoire des rebelles de François Bozizé sur le président d’alors, Ange Félix Patassé. Mais la CPI n’a poursuivi qu’un seul acteur, marginal dans les crises successives que connait la Centrafrique. Le congolais Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la République démocratique du Congo (RDC), avait envoyé sa milice soutenir le régime vacillant de Bangui, et a été condamné à 18 ans de prison pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Depuis plus de 15 ans, la FIDH, qui a sans cesse documenté les crises centrafricaines, constate que les principaux acteurs des déstabilisations du pays sont toujours les mêmes, et toujours impunis.
Partage des cibles ?
Qui aura primauté pour juger ? C’est l’une des bizarreries de cette architecture inédite. La CPI n’intervient qu’en dernier recours, si un Etat n’a pas la volonté ou les moyens de juger. Mais le Statut de la Cour spéciale stipule néanmoins qu’elle devra renvoyer à la CPI toute affaire sur laquelle cette dernière aurait décidé de poursuivre. « Au lieu d’exercer un pouvoir discrétionnaire, le procureur spécial devra, en fait, demander la permission au procureur de la CPI sur toute enquête potentielle », explique Patryk Labuda. Mais avant même que la Cour spéciale ne soit en place, le partage des cibles s’est de fait imposé : une poignée de hauts responsables des crimes serait envoyé à la Cour, tandis que la CPS pourrait se charger d’une centaine de dossiers visant des criminels de rangs intermédiaires. La CPI ne devrait conduire qu’un à deux dossiers dans chaque camps. Celui de la Séléka, la coalition rebelle majoritairement musulmane qui s’était emparée de Bangui en mars 2013, plaçant au pouvoir Michel Djotodia, avant d’être chassé par la force française Sangaris. Et celui des anti-balaka, milice formée de proches de l’ancien président Bozizé et qui avaient riposté. Interrogé, le bureau du procureur affirme que des dossiers pourraient être renvoyés à la Cour spéciale ou aux juridictions nationales « dans les cas où la CPI estime que d’autres systèmes sont mieux placés pour enquêter ou poursuivre ». Une fois ses dossiers complétés, la CPI laisserait-elle le soin à la CPS de conduire les procès ? Cela aurait le mérite d’éviter les écueils potentiels d’une justice à deux vitesses. Quoi qu’il en soit, jusqu’ici, les autorités centrafricaines ont toujours affiché leur volonté de coopérer avec la Cour, éloignant une possible concurrence. « Si la CPI n’essaie pas d’élargir les enquêtes contre les anti-balaka, dont certains sont très proches du gouvernement actuel, il y aura une entente cordiale entre la CPS, la CPI et le gouvernement, prédit Patryk Labuda, mais la situation politique peut évoluer très rapidement et les enquêtes de la CPI peuvent devenir très gênantes. Le cas échéant, l’entente cordiale changera en concurrence. »
Le chantage de l’amnistie
Une chose est sûre, les deux juridictions ne jouent pas dans la même cour. Pour 2017, la procureure de la CPI consacre un budget de plus de 6 millions d’euros à la seule enquête Centrafrique. La Cour spéciale, elle, disposera, d’un budget de 7,4 millions de dollars (6,6 millions d’euros) pour les 14 premiers mois d’exercice, incluant, en plus des enquêtes, la totalité de son fonctionnement. La CPS devrait obtenir 25 millions de dollars (22,6 millions d’euros) pour les cinq premières années d’exercice. Le plus important, « c’est de ne pas créer un nouvel éléphant blanc, une machine à gaz », estime Florent Geel. Le militant de la FIDH estime que la mise sur pied de la CPS « montre la volonté et le besoin de justice. » Une justice qui sera rendue sur le territoire des victimes. Mais l’architecture judiciaire centrafricaine est fragile. Le 10 mai, Amnesty International lançait une campagne, s’opposant notamment à toute amnistie que les rebelles tentent d’obtenir, en échange du désarmement. Selon la presse Centrafricaine, le président tchadien et l’Union africaine, tenteraient de convaincre Faustin Archange Touadéra.