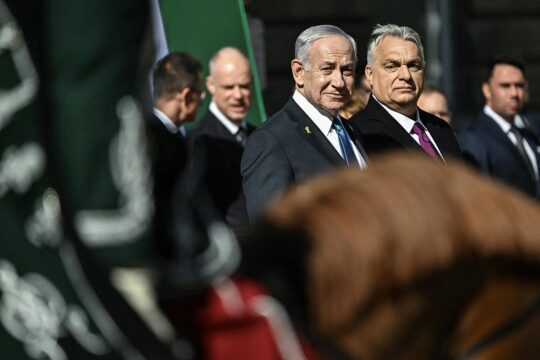Leurs regards nous échappent souvent, masqués ou ombrés par souci de sécurité ou besoin de pudeur, mais c’est comme s’ils nous fixaient à travers ces paires de lèvres brûlantes et ces mains nerveuses, filmées pour parler à la place des yeux, en plan si serré, parfois, qu’on a le sentiment de les respirer. Toute la force du film tient dans ces voix, dans ces récits effarants, dans cette terrible fragilité et ce courage accroché à la peau. Ce sont parfois des femmes, mais ce sont surtout des hommes – de ces Libyens et Libyennes qu’on ne connaissait guère et qui ont été littéralement marqués dans leur chair par la cruauté de la guerre civile qui fait rage dans leur pays depuis 2011.
Quand Kadhafi est mort, une autre guerre a commencé
Leur souffrance s’exprime à travers les mots auxquels ils résistent, la tension ou l’abandon de leur corps quand ils parlent, les nombreuses cigarettes qu’ils consument comme on s’agrippe au fil ténu de la vie. Ils ont rassemblé leurs forces pour raconter à Imed, leur jeune compatriote, comment le viol est devenu dans leur pays une arme de guerre, utilisée par les bourreaux d’hier et les bourreaux d’aujourd’hui, les groupes armés qui déchirent la Libye depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi, emporté par la violence qu’il avait lui-même semé et cultivé. « Quand Kadhafi est mort, une autre guerre a commencé », observe Imed, que tout le monde, dans la réalité, appelle Emad.
« Pour que jamais plus tu ne relèves la tête »
Ce n’est pas le premier film sur les violences sexuelles en temps de guerre. Ce n’est pas non plus celui qui révèle que le viol peut devenir une arme de guerre à part entière, un instrument pensé et méticuleusement utilisé pour soumettre l’ennemi, voire le détruire. Mais c’est peut-être le film qui transformera le plus la perspective que l’on peut avoir de ce crime. Parce que ce sont des hommes qui le racontent.
Il y a Yassine, qui raconte l’humiliation et cette suspicion obsessionnelle que les autres savent. Yassine qui évoque le jour où on les a descendus des véhicules, pieds et poings liés, « comme des bombonnes de gaz ». Et qui comprend la puissance de cette arme qui fut utilisée contre lui et ses camarades. « Ils savaient que le pire, c’était de nous laisser en vie et qu’on n’oublierait jamais ce qu’ils avaient fait. Jamais. »
Il y a Ahmed, qui raconte cette prison, tenue par une famille et sa milice, où un manche de balai était fixé au mur que les détenus devaient s’enfoncer dans l’anus devant leurs tortionnaires, qui filmaient avec leurs téléphones. « Pour que jamais plus tu ne relèves la tête. »
Et il y a Ali, un Tawergha, ces Noirs libyens, descendants d’esclaves, traditionnellement considérés comme des citoyens de seconde zone, instrumentalisés par Kadhafi pour ses basses besognes, notamment à Misrata en 2011, et désormais ciblés par les milices de la « révolution » après la chute du guide suprême. Ali qui raconte un autre aspect sinistre du crime commis en Libye, où les migrants sont contraints à être les instruments de cette politique du viol, victimes-bourreaux pris dans ce piège infernal, enfermés nus, toute la nuit avec les prisonniers tawerghas, forcés de « se monter dessus ».
Le corps comme un terrain de guerre
Et puis il y a l’incroyable Imed, alias Emad, un Tawergha lui-même, qui, entre la Tunisie et la Libye, s’est mis à collecter ces témoignages si ahurissants et si couverts de tabous. Emad qui rassure et dit à ces survivants que « tout peut se dire », prend des notes scrupuleusement, guide et recadre les témoignages avec délicatesse, a suffisamment de force et de détermination pour inviter à ce qu’ils se décantent, et de sensibilité douce et attentive pour savoir demander : « On arrête ? »
Emad qui, dans un calme épuisement au lendemain d’un terrible témoignage, confie à son ami et partenaire Ramadan, un ancien procureur à Benghazi, aujourd’hui exilé à Tunis : « Je m’assombris de jour en jour ». Mais qui ne lâche rien et devient cette impressionnante force tranquille, souffle de vie et espoir de rédemption pour son peuple meurtri. Aux côtés d’autres hommes inestimables, comme ce médecin tunisien, élément subtil et vital de ce fragile « réseau de Tunis », qui reçoit Ahmed, qui reçoit Yassine, et soigne ces hommes dont le corps est devenu « le terrain de la guerre », selon le mot de la juriste française Céline Bardet.

Le silence de la CPI
« Libye, anatomie d’un crime » est cette quête d’Emad, Ramadan et toutes ces victimes qui ont accepté de déchirer le voile de honte et de soumission qui recouvre et protège le crime, avec le concours de la juriste qui les conseille pour que la preuve qu’ils collectent ait une chance d’être efficace, un jour, devant un tribunal international. Mais quelle justice internationale, d’ailleurs ? Le film invoque à plusieurs reprises l’intervention attendue de la Cour pénale internationale (CPI), comme on solliciterait une aide divine. Il cache, du coup, la réalité de l’incommensurable silence et attentisme de la CPI sur ces faits, ces militants et ces victimes de l’ombre, dont le bureau du procureur a connaissance mais qu’il n’est jamais allé rencontrer ni soutenir. N’aurait-il pas été plus urgent de le dénoncer au lieu de masquer cette autre désillusion ?
On regrettera aussi un commentaire en voix off, tout au long du documentaire, au style pauvre, inutilement enflé et incantatoire, répétitif et parfois confus. Mais il restera la voix inoubliable de ces Libyens que ce film honore si justement, qu’il fallait avoir le souci de révéler et le devoir d’écouter, quand bien même ce serait au prix de se demander, comme Khadija, cette femme tawergha violée devant son fils : « Jusqu’où ira cette folie ? »