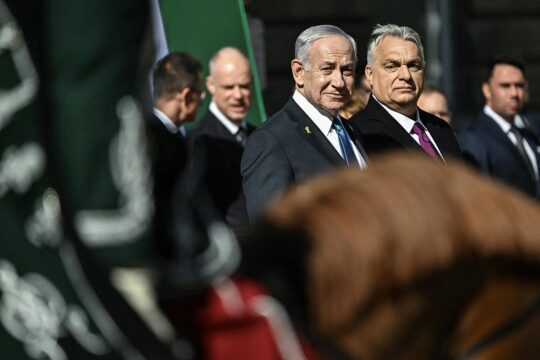En septembre 2011, une association américaine regroupant 10 000 victimes de prêtres de plusieurs confessions, le Réseau de survivants de personnes maltraitées par des prêtres (SNAP, selon son acronyme en anglais), demande au procureur de la Cour pénale internationale (CPI) d’ouvrir une enquête pour crimes contre l’humanité contre le pape Benoît XVI et trois grands cardinaux. « Ces hommes opèrent en toute impunité et sans avoir à rendre de comptes », estime Pam Spees, avocate du Centre des droits constitutionnels (CCR) qui soutient la demande. « Les responsables du Vatican poursuivis dans cette affaire sont responsables de viols et autres violences sexuelles, tortures physiques et psychologiques infligées à des victimes dans le monde entier, à la fois par leur responsabilité hiérarchique et par la dissimulation directe de crimes. Ils devraient être traduits en justice comme tout autre fonctionnaire coupable de crime contre l'humanité », ajoute-t-elle. La demande d’enquête déposée à la CPI accuse les responsables du Vatican de « tolérer et de permettre la dissimulation systématique et généralisée du viol et des délits sexuels contre des enfants dans le monde ». Le site du CCR détaille quelques principes sur lesquels les plaignants appellent à enquêter : « La juridiction de la CPI considère le viol, les violences sexuelles et la torture comme des crimes contre l’humanité. Elle prévoit également une responsabilité pénale individuelle pour ceux qui ont une position de commandement ou de responsabilité hiérarchique sur ceux qui commettent directement de tels crimes. »
Y a-t-il eu un ordre ou une politique concertée ?
Huit mois plus tard, par une lettre au CCR, la CPI écrit que les infractions alléguées ne « semblent pas relever de la compétence de la Cour ». « À ce jour, notre plainte n'a pas été rejetée », précise par email Tim Lennon, président du SNAP. « Les spectaculaires révélations d'abus par le clergé en Australie, en Italie, au Chili et en Argentine continuent de prouver la dissimulation systématique des abus sexuels par la hiérarchie de l'Église. Espérons que notre plainte sera entendue à l'avenir. » Aucune réponse complémentaire n’a pu être obtenue auprès de la CPI. Mais qualifier ces crimes de crime contre l’humanité est-il recevable ?
« Le problème, avec les crimes internationaux, n’est pas vraiment qui les a commis. Le problème, c’est la systématicité, qui implique et a comme accessoire, une planification. [Dans l’Église], il faut se demander s’il y a eu une connexion, un ordre, quelque chose qui a dit à tout le monde du haut de l’Église : ‘si vous faites ça, ce n’est pas un problème’ », explique la juriste internationale Anna Myriam Roccatello, directrice exécutive adjointe du Centre international pour la justice transitionnelle (ICTJ). Dans le cas des abus sexuels perpétrés par des membres du clergé, « on n’aura jamais ça, donc on est faible », ajoute-t-elle.
Selon le statut de Rome, qui fonde la CPI, le crime contre l’humanité est une « attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ». Et la CPI ajoute que l’attaque doit avoir lieu « en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque. » Il faudrait donc prouver que l’Église a couvert les faits au point d’en faire l’axe d’une politique.
L’abstention délibérée d’agir
Devant tous les tribunaux internationaux, même s’ils retiennent des définitions légèrement différentes du crime contre l’humanité, l'élaboration et la mise en œuvre d'une attaque contre l'ensemble d'une population civile nécessitent une organisation élaborée, note l’avocate parisienne Clara Gérard-Rodriguez, qui est également inscrite sur la liste des conseils adjoints devant la CPI. Il faudrait démontrer l'existence d'une politique ou d’un plan préconçu de l’institution ecclésiale, que cette politique soit énoncée ou non formellement, et démontrer que les actes criminels ont été inspirés ou ordonnés par elle. L’acte individuel doit constituer le maillon d’une chaîne et se rattacher à un système ou à un plan. « Dans des circonstances exceptionnelles, une telle politique peut prendre la forme d’une abstention délibérée d’agir, par laquelle l’État ou l’organisation entend consciemment encourager une telle attaque », reprend l’avocate, mais « on ne peut inférer l’existence d’une telle politique du seul fait que l’État ou l’organisation s’abstienne de toute action. »
L’obstacle juridique semble a priori rédhibitoire. Il s’en ajoute d’autres comme le fait que la compétence de la CPI ne couvre pas les faits commis avant juillet 2002, que cette cour ne peut intervenir que si un État refuse de le faire ou n’en a pas les moyens et que ni le Vatican – au statut particulier – ni les États-Unis par exemple, ne sont membres de la CPI.
Imprescriptibilité et responsabilité du supérieur
Qualifier ces crimes de crime contre l’humanité a deux attraits majeurs, notent les experts. Le premier est que le crime devient alors imprescriptible. Pour rappel, en France, un crime sexuel contre mineur ne peut plus être dénoncé pénalement vingt ans après que la victime a passé la majorité. Or, les faits sont qualifiés de crime l’humanité, cette limite saute. La justice pourrait ainsi remonter dans le temps et se saisir d’affaires qui, sinon, lui échapperont.
Le second attrait d’une poursuite pour crime contre l’humanité au niveau international est de pouvoir poursuivre des individus selon le principe de la responsabilité hiérarchique : un supérieur peut devenir responsable des crimes de ses subordonnés s’il savait ou avait des raisons de savoir leur commission et qu’il n’a rien fait pour les punir ou les prévenir. « Dans ce cadre précis [des abus sexuels dans l’Église], il est évident que la hiérarchie savait ce qu’il se passait ; or elle n’a rien fait, alors qu’elle aurait pu réagir. Il y aurait donc là des éléments favorables à une mise en cause des responsables de l’Église, » explique Marina Eudes, maître de conférences en droit public à l’université Paris-Nanterre. Ce principe de responsabilité hiérarchique a fait florès devant les tribunaux internationaux où il a permis de mettre en accusation des chefs d’État ou de gouvernement ainsi que des chefs militaires. Mais au niveau national, ce principe paraît absent. « Il a été créé spécialement dans les crimes internationaux pour justement arriver à viser les penseurs du crime, ceux qui l’ont organisé, plutôt que de s’en prendre aux exécutants. Je ne suis pas sûre qu’on puisse copier-coller cette approche-là en droit pénal interne », prévient Marina Eudes.
En France, par exemple, note Me Gérard-Rodriguez, seuls pourraient être poursuivis de tels hauts responsables « s’ils pouvaient être considérés comme complices des crimes commis, c’est-à-dire qu'ils auraient provoqué l'infraction, donné des instructions pour la commettre ou en auraient facilité la préparation ou la consommation, par aide ou assistance » ou « s’ils avaient commis un autre délit, par exemple la non-dénonciation de crime, voire - pourquoi pas - la mise en danger d'autrui. »
« Toutes les violences sexuelles ne sont pas des crimes contre l’humanité »
Une question d’immunité des poursuites peut également se poser. « Selon le droit des immunités, un État étranger (ainsi que certains de ses dirigeants et diplomates) ne peut pas être poursuivi devant les juridictions pénales d'un autre État. Il faudrait vérifier si ce principe s'applique également au Vatican, mais le fait que le Vatican ait dû lever l'immunité de son ambassadeur Mgr Ventura [nonce apostolique en France de 2009 à 2019, poursuivi dans le cadre d’un dossier d’agressions sexuelles] pour qu'il puisse être poursuivi en France laisse à penser que oui », souligne Me Gérard-Rodriguez.
Tant au niveau international que national, les obstacles juridiques apparaissent donc nombreux et particulièrement résistants pour qu’une cour pénale retienne contre l’Église et ses hauts représentants que les abus sexuels infligés à des milliers de mineurs à travers le monde par des membres du clergé, et souvent couverts par la hiérarchie, relèvent du crime contre l’humanité. En somme, semblent conclure tous les experts interrogés, « toutes les violences sexuelles ne sont pas des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité », selon l’observation de Jean-Pierre Massias, professeur de droit public à l’université de Pau et président de l’Institut francophone pour la justice et la démocratie.