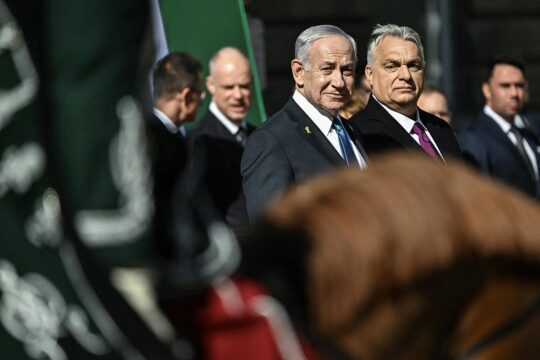Quatre murs de crépi blanc et un toit en tôle de couleur tuile. Toutes les maisons sont identiques, à Shavshvebi, au centre de la Géorgie. La pluie de neige fondue et l’absence d’activité, en cette période de fêtes et de Covid-19, n’incitent personne à mettre le nez dehors. Les allées du lotissement sont parfaitement quadrillées ; il suffit de savoir compter pour arriver chez Natela Kebersaeva, une Ossète mariée à un Géorgien, Levan. Le couple a pris la fuite avec leurs enfants lorsque les premières bombes ont commencé à tomber sur Kermeti, leur village en Ossétie du Sud, le 7 août 2008.
Douze ans après, leur vie a stationné ici, dans ce camp de « déplacés de l’intérieur », au bord de l’autoroute qui mène à Gori, la ville natale de Joseph Staline. Un Géorgien. Natela a créé un atelier de couture, un jardin d’enfant et une petite association, ‘Avec espoir dans l’avenir’, qui travaille avec d’autres ONGs plus importantes basées dans la capitale, Tbilissi. Avant les fêtes, Natela a reçu un message d’Eka, la coordinatrice du bureau local de la Cour pénale internationale (CPI), pour l’informer que le Fonds au profit des victimes ouvrait un programme d’assistance. Un appel à projets va être lancé en mars, précise le message. Va-t-elle y répondre ? « Nous sommes un groupe de responsables, nous déciderons ensemble », répond Natela. « J’ai un petit projet que j’ai appelé ‘Vieillesse digne’, poursuit-elle. Je n’ai que trois bénéficiaires, que j’aide avec des médicaments. Mais je connais au moins une trentaine de personnes qui ne peuvent s’acheter des médicaments ou qui sont en demande de soins psychologiques. » Chaque déplacé touche une aide de l’État de seulement 45 laris par mois (environ 11 euros), précise-t-elle. « Sans solidarité, impossible de survivre. »

30 000 déplacés internes
Tskhinvali, la capitale de l’Ossétie du Sud, territoire amputé à la Géorgie par la guerre de 2008, est à moins de 50 kilomètres. Une destination désormais hors d’atteinte pour tous ceux qui, comme les 177 familles de Shavshvebi, ont fui cette république séparatiste d’environ 50 000 habitants – dont 10 000 militaires russes. Ceux qui y vivent ont une seule voie de sortie, vers le Nord, par le tunnel de Roki et la Fédération de Russie. Plus haut, à 5 000 mètres d’altitude, le mont Kazbek domine cette imposante frontière naturelle qui délimite le Sud du Nord Caucase. A ses pieds, une forteresse militaire russe repérable à son haut pylône de télécommunication s’est établie. Elle contrôle les kilomètres de barbelés sinueux que les Géorgiens appellent « la ligne d’occupation » et les Russes, « la frontière de l’État d’Ossétie du Sud ». En 2008, la Géorgie a dû reloger en urgence et pour le long terme près de 30 000 personnes, venues s’ajouter aux 212 000 déplacés issus d’Abkhazie, majoritairement, et déjà d’Ossétie du Sud, qui avaient fui au début des années 90 les conflits d’après l’indépendance.
Dans sa fuite sous les bombes à travers la forêt, Natela n’avait pu emporter sa mère, alitée, restée dans leur grande maison entourée du verger qui faisait leur relative fortune. D’ethnie ossète, la vieille dame n’était pas une cible pour les milices ossètes, appuyés par l’armée russe, qui s’appliquaient à dépouiller et à faire fuir les Géorgiens. « Les combats ont duré cinq jours, raconte Natela [du 8 au 12 août, faisant 850 morts civils et militaires, ndlr]. Un mois plus tard, les Russes étaient toujours à Gori, c’était le statu quo. J’ai décidé d’aller chercher ma mère, avec l’aide de mon frère qui vit à Vladikavkaz [Ossétie du Nord, pays membre la Fédération de Russie]. » Natela passe les check-points en se mêlant à un groupe de femmes azéries venues vendre des herbes aromatiques. « Tout était effrayant, les voitures sans plaques, les hommes en armes ivres et mal rasés. J’ai retrouvé mon frère et nous sommes arrivés au village. Pas une maison debout, toutes étaient brûlées, rasées, pillées. Ma mère avait disparu. Nos vaches erraient dans le jardin, un diplôme et des photos trempaient dans la boue, avec des fourchettes et des morceaux d’assiettes. »
« Nous avons tout perdu »
Natela va trouver la Croix rouge, à Tskhinvali. Déclare la disparition de sa mère. Repasse les check-points dans l’autre sens. Plus tard, son frère resté en Ossétie aura des nouvelles de leur mère. « Des Ossètes l’avaient trouvée étendue dans le jardin, choquée, et il a fallu attendre trois mois pour qu’elle se souvienne de son nom, dit Natela. Mon frère s’en est occupé, à Vladikavkaz, durant les six années qui lui restaient à vivre. Je n’ai pu ni la revoir ni l’enterrer. Nous avons tout perdu, ce que nous possédions, nos proches, nos relations. »
Natela balaye du regard la tapisserie molletonnée du salon. « Le 3 décembre 2008, nous avons eu cette maison. » 63 m2 de surface habitable, un petit lopin de terre et un jardin, où son mari a planté sa vigne. Une culture ancestrale en Géorgie, qui lui permet d’honorer une tradition : offrir à goûter au visiteur le vin de la maison. Nous trinquons à l’avenir. La CPI peut-elle y contribuer ? « Je ne sais pas qui doit être puni, lâche Natela. Je sais seulement que la Russie a occupé 20 % du territoire de la Géorgie et qu’elle devrait payer pour cela. Le gouvernement a une longue liste de propriétés perdues. » La Géorgie, État-partie à la CPI, l’avait contactée dès les premières heures de la guerre. Après huit ans d’examen préliminaire, en 2016, elle a ouvert une enquête. Quatre ans plus tard, à Shavshvebi, personne ne semble plus attendre ses conclusions. Des Russes en procès à la CPI, personne n’y croit.
Une centaine de kilomètres à l’Est, et c’est la frontière de l’Azerbaïdjan. Ici, 123 familles d’Ossétie du Sud ont été relogées dans une barre d’immeuble à la peinture écaillée. La ville s’appelle Gardabani et est surtout célèbre à Tbilissi pour sa centrale thermique, le « bloc n°9 », qui plongeait régulièrement la capitale dans le noir. « Nous avons entendu parler de la CPI, bien sûr ! », s’esclaffe Tina Nebieridze, 73 ans. Cette déplacée d’Ossétie raconte et mime avec force gestes sa fuite du village de Kekhi, sa détention dans une prison de Tskhinvali rebaptisée ‘camp de concentration’ par ses occupants (« c’était une cage ; d’en haut, on nous jetait du pain sec et des lames de rasoir pour qu’on se suicide »), son échange onze jours plus tard contre des prisonniers de guerre ossètes pris par l’armée géorgienne (« je voulais les étrangler, ils étaient si propres »). « Je n’ai plus aucun espoir dans la justice, lance-t-elle. Cela fait douze ans qu’ils se moquent de nous, le gouvernement comme les autres à Strasbourg ou à La Haye. Je suis malade, je prends des médicaments, mes voisines m’aident pour les courses mais je n’ai personne, et il ne me reste qu’une chose à faire : donner mon appartement à quelqu’un qui, en échange, m’enterrera. » Sa colère bravache fait rire ses voisines. Elle glisse une pomme et un gâteau dans nos poches, nous accompagne en boitant à l’ascenseur. « Le gouvernement vient de l’installer ». Il est en panne.

L’assistance aux victimes : « La seule chose qui peut avoir un sens »
Retour à Tbilissi. « Je ne pense pas que l'enquête de la CPI sera couronnée de succès. Pour la Géorgie, c'est fini, c'est fait, la seule chose qui peut avoir un sens est le mandat d'assistance aux victimes. » L’élégant Nika Jeiranashvili, de l’organisation International Justice, portant cravates colorées et moustache retroussée, a dédié à cette question l’essentiel de sa vie ces dernières années, en allant s’installer à La Haye. « Nous sommes 5 ou 6 organisations à y travailler, explique-t-il. Nous travaillons avec les victimes, nous fournissons des soins médicaux, des services de réhabilitation psychologique, des services juridiques et une représentation devant les tribunaux à Strasbourg et à La Haye. Nous essayons de défendre les victimes mais personne ne s'en soucie, elles ne sont plus à l'ordre du jour. »
D’autres activistes géorgiens ne cachent plus leur déception. « Lorsque nous avons commencé à travailler activement avec la CPI, notre espoir s'est évanoui. Chaque réponse de leur part était du genre ‘c'est confidentiel’ ou ‘nous pouvons le faire sans vous’. Il nous a fallu cinq ans, mais la confiance des victimes et de la société civile a disparu », explique Nino Jomarjidze, de l'Association des jeunes avocats géorgiens, Gyla, qui représente 300 des 5 782 victimes géorgiennes “participant” officiellement à la procédure devant la CPI. Nino Tsagareshvili, du Centre des droits de l’homme HRIDC, dénonce une « approche non orientée vers les victimes ». « La décision de la CPI de recevoir les demandes de victimes ne donne pas lieu à des droits formels, il n'y a pas de procédure pour soumettre des informations ou des preuves. C'est un problème de ne pas pouvoir être en prise avec la Cour. »
Six mois d’enquête auprès de 2 400 familles
Dès lors, comme si elle attendait Godot, la société civile géorgienne a entrepris de militer pour une intervention du Fonds au profit des victimes. Ce n’était jamais arrivé avant l’ouverture d’une affaire. Ils y sont parvenus. Ce lobbying a reposé sur une étude extrêmement fournie auprès des déplacés, dix ans après la guerre. « En 2018, nous sommes allés à la rencontre des victimes, décrit Tsagareshvili. Six mois de travail, qui nous ont permis d’interroger 2400 familles dans 36 sites de déplacés sur leurs conditions de vie, leurs besoins, leurs attentes. » Le rapport pointe les carences de la CPI : faute de travail de sensibilisation et d’information publique, peut-on lire, seules « 49 % des victimes ont répondu avoir entendu parler de la CPI, et qu’elles avaient peu d’information sur le travail, le mandat, et le rôle de la Cour. »
Mais surtout, l’étude réalisée offre une mine d’informations et de recommandations, transmises à la CPI et au Fonds au profit des victimes, sur les conditions de logement, de transport, de communication, d’accès à l’éducation, à l’emploi, à la santé, des déplacés de 2008. « Il s’agissait de gagner du temps », explique Jeiranashvili. « Nous leur avons donné beaucoup d’information », souligne Jomarjidze. Le Fonds a néanmoins recruté un consultant, Ucha Nanuashvili, ancien Médiateur (Ombudsman) de Géorgie, pour réaliser une évaluation. « Un copié collé, pour l’essentiel, du travail de la société civile », peste un militant. Ce document n’est pas public mais un résumé doit être publié en février par le Fonds, nous indique Nanuashvili. Interrogé sur ses recommandations, il précise : « Il y a un besoin de soutien matériel, d'aide à la création de moyens de subsistance, de programmes générateurs de revenus car le chômage est un problème grave parmi les victimes. En outre, une forme de réadaptation psychologique, des soins médicaux sont un autre domaine où les victimes ont besoin d'une certaine assistance. »
Sans justice, la réhabilitation sera incomplète
Deux ans se sont ainsi à nouveau écoulés. Le 10 novembre 2020, le conseil d’administration du Fonds a décidé d’allouer 600 000 euros pour un programme d’assistance de trois ans. Une décision annoncée par communiqué et dans une vidéo, enregistrée en géorgien par l’un des membres du comité de direction du Fonds, Gotcha Lordkipanidze. Actuel ministre de la Justice de Géorgie, il est aussi l’un des six nouveaux juges récemment élus par l’Assemblée des Etats-parties à la CPI. Dans les semaines qui viennent, le Fonds devrait publier un appel à projets. Et une nouvelle attente va pouvoir débuter, après soumission des candidatures. « Dans le meilleur des cas, l’assistance aux victimes ne commencera pas avant l'année prochaine », estime Jeiranashvili. « La réhabilitation seule serait stupide, dit-il, le principal problème est de trouver un emploi pour les personnes déplacées. Beaucoup sont des agriculteurs, des viticulteurs, ils savent fabriquer des vêtements, ils ont des métiers. »
Mariam Jishkariani est à la tête d’une ONG fondée en 1996, RCT Empathy, spécialisée dans le traitement psychosocial des traumatismes liés aux tortures et à la guerre. Elle est en contact avec la Section de la participation des victimes et des réparations et avec le bureau du procureur de la CPI, concernant les dossiers de 140 personnes touchées par la guerre. Pour Jishkariani, l’arrivée du Fonds est une opportunité qui lui permettrait de répondre, de façon « holistique » dit-elle, aux demandes des enquêteurs de la CPI, qui exigent des mois de travail non rémunéré. Les avocats aussi travaillent pro bono, lorsqu’il s’agit de la CPI.
« Un nettoyage ethnique, cela doit être reconnu »
« Certaines victimes sont âgées, certaines sont décédées du fait de l’âge, du stress de la guerre, des changements sociaux brutaux, de maladies chroniques, constate Jishkariani. Elles ont besoin de soins médicaux, psychologiques, mais aussi de recours juridiques effectifs. Leur réhabilitation sera incomplète sans cela. Elles étaient au beau milieu d’un nettoyage ethnique, cela doit être reconnu. » « À l'heure actuelle, le Fonds représente une chance de faire quelque chose pour les victimes qui perdent tout simplement espoir car elles ne voient aucun auteur arrêté, aucune indemnisation fournie », espère de son côté Tsagareshvili.
L’attente continue.