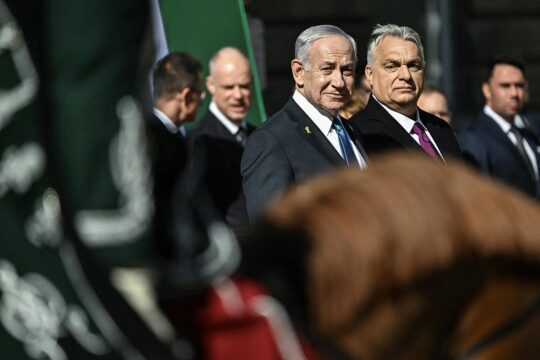Au début de cette année, l’ancien président de la Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo, a été acquitté par la Cour pénale internationale (CPI) après avoir été détenu à La Haye pendant plus de sept ans. Son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, a également été libéré. Ces acquittements étaient les derniers d’une plus longue série. Depuis des années, le bureau du procureur a été marqué par des problèmes d’enquêtes, de gestion et d’autres scandales qui ont gravement affecté sa réputation. Depuis l’ouverture de la CPI en 2002, seuls trois accusés ont été reconnus coupables par la Cour, tandis que les poursuites contre douze autres accusés ont été – avant, au milieu ou à la fin de leur procès – abandonnées par manque de preuves.
Mais ce sont maintenant les juges qui sont au centre de la controverse. En janvier, le New York Times a écrit qu’un certain nombre de juges de la CPI avaient intenté une action en justice devant le tribunal de l’Organisation internationale du travail. Avec un salaire annuel non imposable de 180 000 euros, ils réclament une augmentation de salaire de 26 %, une compensation rétroactive, plus de retraite et des dommages et intérêts « qui pourraient se chiffrer en millions », selon le NYT. Cette initiative est menée par le président de la CPI, Chile Eboe-Osuji (qui gagne 18 000 euros supplémentaires par an, en tant que président). Bien que douze juges sur dix-huit ne se soient pas joints au procès, l’affaire mine l’image du tribunal.
Le conflit d’intérêts de la juge Ozaki
La nouvelle de ce conflit salarial a été suivie d’un scandale mettant en cause la juge japonaise Kuniko Ozaki. Celle-ci fait partie de la chambre chargée du procès contre l’ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda. Ntaganda s’est rendu à la Cour le 22 mars 2013. Son procès s’est ouvert le 2 septembre 2015 et les plaidoiries finales ont eu lieu en août dernier. Les juges rédigent actuellement le jugement. Le mandat d’Ozaki avait pris fin en mars 2018, mais elle devait rester jusqu’à ce qu’un verdict soit rendu.
Soudain, le 7 janvier 2019, Ozaki envoie un mémorandum interne à la présidence du tribunal, demandant à démissionner « en tant que juge à plein temps » à partir du 11 février 2019. Pour des raisons personnelles, écrit-elle. Une semaine plus tard, le 18 février, elle informe ses collègues qu’elle a été nommée ambassadrice du Japon en Estonie et que ses fonctions diplomatiques commenceront le 3 avril. « Je suis fermement convaincue que ma nouvelle responsabilité n’interférerait en rien avec ma fonction judiciaire », précise-t-elle alors. Ozaki demande la permission de combiner les deux postes et, si cela ne s’avérait pas possible, elle démissionnerait tout simplement de la CPI.
Le 4 mars, les juges organisent une réunion plénière pour discuter de la question. Ils décident, à une majorité de 14 juges, que la combinaison de ces emplois « ne viole aucun aspect » de l’article 40 du Statut de Rome qui traite de l’indépendance des juges. L’article stipule que les juges « ne doivent exercer aucune activité susceptible d’interférer avec leurs fonctions judiciaires ou de porter atteinte à la confiance en leur indépendance », qu’ils exercent « à plein temps » en dehors de « toute autre activité de nature professionnelle ». Une minorité de trois juges s’opposent à la nouvelle fonction diplomatique d’Ozaki, en affirmant qu’il était « évident » qu’un juge exerçant une « fonction exécutive ou politique » pour un gouvernement « était tout à fait susceptible d’affecter la confiance du public dans l’indépendance judiciaire ».
Demande de récusation
Le 1er avril, les avocats de la défense de Ntaganda déclarent qu’Ozaki devrait être récusée en raison de sa nomination diplomatique et de sa conduite dans ce dossier. L’équipe de défense estime qu’il y a « un risque sérieux » que le droit de leur client à un procès équitable soit violé. La Chambre de première instance rejette toutefois la demande de la défense de suspendre temporairement la procédure pour débattre la demande de récusation.
Le 30 avril, l’équipe de défense demande à la présidence de reconsidérer sa décision selon laquelle le travail diplomatique d’Ozaki ne constituait pas une violation de l’article 40. Les avocats soulignent que le fait de servir le gouvernement du Japon « donne l’impression qu’elle n’est pas indépendante » et qu’un « observateur raisonnable » pourrait soupçonner qu’un ambassadeur veuille éviter la controverse au moment de choisir entre une condamnation ou un acquittement dans « une affaire très médiatique ». Son poste diplomatique, disent-ils, est « clairement incompatible avec ses fonctions judiciaires ».
Un jour plus tard, la présidence révèle que la juge Ozaki a démissionné de ses fonctions d’ambassadeur. En fait, le tribunal avait déjà été informé le 23 avril par courriel par le ministère japonais des Affaires étrangères de sa démission, qui avait elle-même eu lieu le 18 avril. Il est toutefois peu probable que cette saga s’arrête là. La défense a réitéré sa demande auprès de la présidence de divulguer les documents et informations relatifs à l’affaire.
Pas d’enquête en Afghanistan
Pendant que le scandale d’Ozaki se déroule, la CPI publie la décision tant attendue sur l’Afghanistan. Le 20 novembre 2017, le procureur avait demandé l’autorisation d’ouvrir une enquête sur les crimes internationaux commis par les talibans, les forces de sécurité afghanes, l’armée américaine et des responsables de la CIA en Afghanistan et dans des centres secrets de détention de la CIA en Pologne, en Roumanie et en Lituanie.
Entre-temps, le gouvernement des États-Unis avait ouvertement menacé la Cour si elle osait poursuivre des Américains. Dans un discours au vitriol prononcé l’an dernier, John Bolton avait qualifié la CPI d’« inefficace », « irresponsable », « carrément dangereuse » et « illégitime ». Le conseiller américain à la sécurité nationale avait averti la CPI que son pays ferait tout pour empêcher le tribunal d’enquêter sur les Américains. Les juges et les procureurs se verraient interdire l’entrée aux États-Unis, leurs comptes bancaires seraient gelés et ils pourraient même être poursuivis. Il en irait de même pour les entreprises et les États qui participeraient à une enquête de la CPI.
Le 4 avril 2019, les États-Unis révoquent le visa de la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. Une semaine plus tard, le 12 avril, une Chambre préliminaire de la CPI rejette la demande de l’accusation d’ouvrir une enquête en Afghanistan. Les trois juges conviennent qu’il existe « un fondement raisonnable » à la commission de crimes relevant de sa compétence, mais ils déclarent qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de poursuivre cette affaire. La « complexité et l’instabilité du climat politique qui entourent la situation afghane rendent extrêmement difficile d’évaluer les perspectives d’obtenir une coopération significative », ce qui est nécessaire pour le succès des enquêtes et l’interpellation des suspects, déclarent les juges. Ils soumettent que l’absence de résultats créerait « de la frustration et éventuellement de l’hostilité à l’égard de la Cour » chez les victimes. Les juges ajoutent qu’une enquête sur l’Afghanistan nécessiterait des ressources financières et humaines, au détriment de « scénarios » ayant « des perspectives plus réalistes de conduire à des procès et de promouvoir ainsi effectivement les intérêts de la justice ».
« La fin de la CPI ? »
Cette décision déclenche une avalanche de critiques. Param-Preet Singh, directrice adjointe sur la justice internationale à Human Rights Watch, déclare que c’est « un coup dévastateur pour les victimes qui ont subi des crimes graves sans avoir de recours ». Elle souligne le fait que « la logique des juges permet, de fait, aux pays membres de retirer leur coopération avec la Cour et envoie à tous les gouvernements le message dangereux que les tactiques d’obstruction peuvent les mettre hors de portée de la Cour ».
Les universitaires commentant sur tweets et blogs se divisent selon des approches pragmatiques ou fondées sur des principes. Alex Whiting, professeur à la faculté de droit de Harvard et qui a travaillé pour le bureau du procureur de la CPI, fait preuve d’une certaine compréhension dans son article sur Just Security, soulignant qu’en tant qu’ « institution novice, il pourrait être nécessaire à la Cour de se construire et de s’imposer par petits pas, en se concentrant sur les situations où le soutien international lui permettra de réussir ». Mais Sergey Vasiliev, professeur adjoint au département de droit pénal à l’Université d’Amsterdam, publie un article en deux parties sous ce titre menaçant : « Pas juste une autre ‘crise’ : le blocage de l’enquête sur l’Afghanistan pourrait-il signifier la fin de la CPI ? »
Ce qu’un juge français aime ou n’aime pas
Pour couronner le tout, un vieux discours du 17 mai 2017 prononcé par le juge français Marc Perrin de Brichambaut devant des étudiants chinois à la faculté de droit de l’Université de Pékin provoque aujourd’hui un nouveau chahut. Dans son exposé, le juge émet une série de remarques désobligeantes. Il déclare que ce sont les pays européens qui paient les factures de la CPI, tandis que les pays africains « fournissent les suspects ». Le juge, qui est bien sûr bien payé lui-même, parle d’un avocat des victimes pour dire qu’il avait fait un bon choix parce qu’en travaillant sur l’affaire Dominic Ongwen, l’ex-commandant de la LRA, il se trouve « maintenant bien occupé pour les prochaines années ». Il donne son avis sur les avocats de la défense David Hooper et une « avocate de Paris », en précisant qu’elle est « encore plus pénible que M. Hooper parce qu’elle tire sur tout ce qui bouge en face d’elle. Elle n’a jamais rencontré de victime non plus, mais elle est très efficace pour défendre leurs intérêts et rend la vie de la Chambre un peu désagréable parfois. Donc, je n’aime pas du tout Madame Mabe et je n’ai pas non plus beaucoup de respect pour M. Hooper », dit-il, faisant probablement référence à Catherine Mabille, avocate de la défense de Thomas Lubanga Dyilo. Entre-temps, le 10 avril, Me Mabille a déposé une requête en récusation du juge français, en raison de ses remarques relatives à la procédure de réparation dans l’affaire Lubanga, qu’il préside.
La CPI ne sera jamais considérée comme crédible si ses juges annoncent ouvertement, sincèrement ou non, qu’ils se sentent libres d’ignorer des dispositions importantes du Statut de Rome qu’ils n’aiment pas personnellement.
Et ce n’est pas tout. Il y a un autre point que Kevin Jon Heller, professeur associé de droit international public à l’Université d’Amsterdam, a soulevé dans un blog pour Opinio Juris. Dans son discours de 2017 à Beijing, le juge Perrin de Brichambaut révèle que lui et les deux autres juges menant le procès contre l’ancien homme politique congolais Jean-Pierre Bemba Gombo et quatre autres personnes accusées d’avoir soudoyé des témoins, s’étaient mis d’accord pour refuser les appels interlocutoires. Heller souligne que le Statut de Rome permet aux parties d’interjeter appel d’une « décision qui porte sur une question susceptible d’affecter sensiblement le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l’issue du procès ». Se référant aux remarques du juge, Heller dit qu’il est « impossible de surestimer à quel point de telles déclarations peuvent être imprudentes et dommageables. (...) La CPI ne sera jamais considérée comme crédible si ses juges annoncent ouvertement, sincèrement ou non, qu’ils se sentent libres d’ignorer des dispositions importantes du Statut de Rome qu’ils n’aiment pas personnellement. »
Ainsi, pas moins de quatre controverses ont été soulevées au cours des premiers mois de cette année : la procédure sur les salaires, le scandale Ozaki, le rejet de l’enquête sur l’Afghanistan et le discours du juge français. Si l’on considère que les juges sont choisis pour leur impartialité et leur intégrité et que leur conduite suscite chaque mois des remous et des doutes dans le public, la Cour a de quoi s’inquiéter.