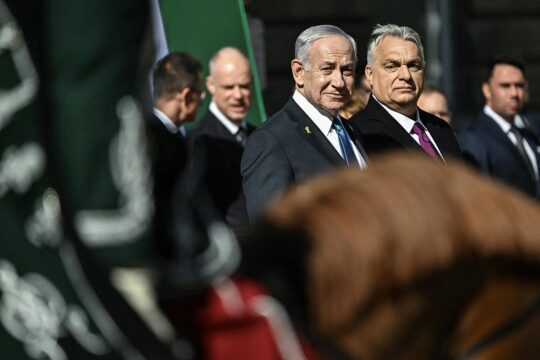La nuit est tombée lorsque Nika Jeiranashvili nous ouvre en grand le haut portail en acier forgé bleu délavé de la maison familiale, à Kolagi, à deux heures de route de Tbilissi, la capitale géorgienne. Sous les tonnelles colonisées par la vigne grimpante, un feu de sarments crépite, prêt à recevoir les généreuses shashliks (brochettes de porc) empilées sur un plat en inox, disposé sur un tonneau. Nika sourit, l’air est frais, humide. Le juriste international reconverti dans le vin nature a troqué ses élégants costumes et cravates de couleur contre un pull à mailles gris, plus adapté au frima de cette fin d’hiver en Kakhétie. La région produit 75 % des vins de Géorgie, berceau mondial du vin où les premières vinifications remontent, dit-on, à 8000 ans.
« Je suis heureux ici, je respire, je me lève tôt et je travaille dur, mais je ne me sens jamais fatigué comme je l’étais durant toutes ces années à batailler avec la CPI », lâche comme un aveu joyeux celui qui a porté à bout de bras le plaidoyer de la société civile géorgienne devant la Cour pénale internationale (CPI). C’est dans ses couloirs de verre et de métal froids que j’avais croisé pour la première fois Nika, sa moustache impériale et sa politesse immuable, en septembre 2017. Le juriste géorgien en arpentait les bureaux, en scrutait les soubresauts, depuis l’ouverture, début 2016, de l’enquête de la CPI sur la guerre russo-géorgienne de 2008, à l’issue de laquelle 20 % du territoire de la Géorgie s’est retrouvé de facto occupé par la Russie. Financé la première année par la fondation américaine Soros, il avait vite créé sa propre organisation, Justice International, « pour plus de flexibilité dans notre plaidoyer auprès de la Cour et des États ». Nika était, pour la CPI, la figure de la coalition des organisations géorgiennes qui y représentaient les victimes ; et, pour les Géorgiens, le porte-parole officieux d’une CPI qui de fait n’en avait pas.
« La première fois que quelqu’un m’a dit merci pour ce que j’ai fait »
Dans la fumée blanche autour du feu apparaissent tour à tour Andro, son père ancien procureur militaire, et Nina, sa femme cheffe cuisinière à Tbilissi, venus saluer les visiteurs et surveiller du coin de l’œil la cuisson des shashliks. Un ami d’enfance du père, Vano, qui n’a jamais quitté le petit village de Kolagi, chambre ce dernier sur la façon dont les brochettes ont été taillées. Le vin et la nourriture sont affaires très sérieuses en Géorgie, et rien ne peut se dire de vraiment profond sans passer par le rituel de la tablée rythmée par les tamadas, les toasts prononcés par l’hôte. La table, dressée au rez-de-chaussée de la bâtisse ancestrale est simple et généreuse. Une porte sépare la pièce de la salle des kvevris, ces jarres d’argile enterrées dans le sol où le vin est traditionnellement vinifié en Géorgie. La demeure familiale au confort rustique – « on la réparera plus tard », évacue d’un geste Nika – a été meublée dans le style chic soviétique par un grand-père gouverneur.
La fierté de Nika est de reprendre la fabrication du vin, initiée « il y a 136 ans » par son lointain aïeul, dans le petit domaine familial baptisé Kolagis. « C’est notre histoire, il s’appelait Nika, je porte son nom et c’est moi qui essaie de continuer. » Trois ans plus tard et après une saison 2023 catastrophique sur le plan climatique, l’affaire n’est « pas du tout rentable », dit-il, avec ses trois à cinq mille bouteilles par an, pour six cuvées distinctes. Mais ses voisins viticulteurs l’ont adopté, sourit-il, et en particulier Zura Mghvdliashvili, un pionnier du vin naturel dont Nika nous fera goûter les flacons aux notes ambrées, fruitées et tendues. D’anciens cépages qu’il modernise, comme son élève, en surfant notamment sur le succès récent d’un vin festif baptisé Pet’ Nat (Pétillant naturel, en français sur l’étiquette).
« C’est dur, de monter son nouveau business, sa marque, souligne Nika. Personne ne te connaît, tu n’as pas d’expérience et tu fais beaucoup d’erreurs. Ma chance est d’avoir rencontré Zura, un des meilleurs vignerons, qui m’avait vu à la télévision, il connaissait mon travail [avec la CPI]. Quand je l’ai rencontré, il pensait que c’était pour m’amuser, il ne me voyait pas tourner le dos à tout ça. Je lui ai dit ‘non, j’ai arrêté’. Il a été choqué et il a dit ‘tu as tellement fait pour les gens et pour le pays, alors je vais t’aider, je vais partager toutes mes connaissances et mon expérience, je vais te dire des choses que je ne dirai à personne’. Sans lui, je pense qu’il m’aurait fallu au moins cinq ans de plus pour arriver là où je suis. C’est peut-être la première fois que quelqu’un m’a dit merci pour ce que j’ai fait. »
La dégustation se poursuit jusque tard dans la nuit. Nika parle de la perfection qu’il recherche dans son vin, comment il le fusionne avec la cuisine de Nina, et ne tarit pas d’éloges sur les habitants de Kolagi qu’il côtoie au quotidien depuis plus de trois ans. « Ici, je rencontre des gens honnêtes, des gens qui travaillent dur, et je les aime bien. Dans le village, ils me respectent parce qu’ils ont vu à quel point je travaille comme eux. Personne ne ment ou n’essaie de vous manipuler. C’est un grand soulagement. »

Ignorance et naïveté
Le lendemain matin, Nika n’est pas allé à la vigne. Le temps est voilé, il pleut par intermittence. L’atmosphère évoque « le temps pourri » des Pays-Bas, rit-il, assis près du chauffage au gaz, à l’étage, dans la véranda qui donne sur les montagnes du Caucase.
Était-ce difficile, de quitter le monde de la justice internationale ? « Cela n’a pas été facile, car j’ai dû repartir de zéro, commence Nika. Toute ma formation, mon expérience, mon nom, tout était dans ce domaine, si bien que je perdais pratiquement la moitié de ma vie. À l’époque, j’avais 32 ans. J’en ai 36 aujourd’hui. Lorsque vous allez dans les vignes, que vous commencez à travailler, que vous regardez la nature, vous ressentez une telle liberté. Lorsque vous êtes assis dans un bureau, votre tête est remplie de tant de choses négatives, de politique, de conflits, d’histoires de victimes. Toutes sortes de choses qui vous affectent. » Il marque une pause. « D’une certaine manière, c’était facile parce que j’étais sûr. J’étais sûr à 100 % que ce n’était pas acceptable de continuer comme ça. »
Le désenchantement l’a gagné par métastases, après son déménagement à La Haye. « Au départ, on pense que ce sera génial, on est très enthousiaste, puis on voit ce qui se passe dans la pratique », poursuit-il. « J’ai aidé la Cour à rédiger sa stratégie sur la Géorgie, à faire une cartographie de qui est qui. J’avais un ‘pass’, j’y allais tous les jours. »
Nika constate d’abord que ceux qui y travaillent « ne se parlent pas entre eux, qu’il n’y a pas de réelle coordination ». Il y a pire. Lorsque les officiels de la CPI préparent leur première mission en Géorgie, dit-il, « ils ne savaient même pas quelle langue les gens parlaient ici, et certains me demandaient si l’on parlait français en Géorgie ». « Ils étaient présents en Côte d’Ivoire, au Mali, en République démocratique du Congo, ils n’avaient semble-t-il pas réalisé qu’il s’agissait d’un continent différent », fulmine le Géorgien.
Puis ils sont allés en Russie et ils sont revenus en lui disant qu’ils pensaient que Moscou allait coopérer avec la CPI. « Ils nous ont bien traités, ils nous invités au restaurant… », lui assurent-ils. « Mais de quoi parlez-vous ? Vous pensiez qu’ils allaient vous accueillir avec des armes de guerre ? » L’enfant du Caucase, bercé par les guerres d’Abkhazie, d’Ossétie, de Tchétchénie, n’en croit pas ses oreilles. Moscou se chargera de doucher la naïveté des membres du tribunal de La Haye quelques semaines plus tard, en annonçant le retrait de sa signature du Statut de Rome, fin 2016, alors que s’ouvre l’Assemblée des États parties.
Incompétence et maladresses
La priorité pour Nika n’est rapidement plus d’obtenir des procès mais de « limiter les dégâts ». « Vous vous rendez compte que, bien sûr, le tribunal [de La Haye] ne va pas attraper un général russe ou Poutine. Tout d’abord parce qu’il n’a jamais réussi. Dans toutes les [autres] situations, il a échoué, ou il a même créé plus de problèmes qu’auparavant. Et c’était aussi le risque en Géorgie. Je l’ai expliqué au tribunal. En raison des tensions entre le parti [pro-russe] au pouvoir et l’opposition, le gouvernement pourrait essayer d’envoyer les fonctionnaires de l’ancienne administration en prison, leur ai-je dit. Si la CPI avait commis cette erreur, cela aurait pu provoquer une guerre civile en Géorgie. »
Ne voyant pas d’issue judiciaire réaliste pour ce premier dossier « hors Afrique » de la CPI, le juriste contribue à porter le plaidoyer des ONG géorgiennes pour une intervention du Fonds de la CPI au profit des victimes au titre de son « mandat d’assistance ». Les ONG appuient leur demande par un rapport méticuleusement documenté, « 10 ans après la guerre », en 2018. Le programme ne démarre qu’en avril 2023. « A nouveau, cela a pris tellement de temps, soupire Nika. Sans la bureaucratie interne, on aurait gagné des années. »
Un autre grand plaidoyer semblait avoir porté : celui de l’ouverture d’un bureau de la CPI en Géorgie, fin 2017. « Ils l’ont fait, mais là c’est le chef de ce bureau qui a été mal choisi. Un diplomate estonien. Il avait une expérience en Géorgie, de monitoring des frontières pour la mission de l’Union européenne. Il a menti en disant qu’il parlait géorgien. » L’action du bureau est restée peu visible. « Ce gars n’a rien fait la première année, à part quelques interventions dans des universités. Nous lui disions ‘faites votre travail, allez dans les camps de réfugiés, rencontrez les victimes, faites de la sensibilisation’. Et quand il l’a fait, il est allé à la rencontre des gens d’Abkhazie [déplacés de la guerre du début des années 90] et non d’Ossétie [qui ont fui la guerre de 2008, objet de l’enquête de la CPI], à qui il a parlé en russe. Ils étaient choqués. Imaginez, vous vivez dans des conditions dures depuis des années, un gars de la CPI vient vous voir, vous avez un espoir, vous l’écoutez… Pour eux c’était simple, ils ont pensé que la Russie était tellement puissante qu’elle contrôlait la Cour. »
« Ils vivent comme des rois à La Haye »
Nika est lancé. « Quand vous voyez cela, votre perception change, vous ne voyez déjà plus l’institution comme professionnelle. Vous voyez des gens qui touchent des salaires élevés, avec tous les avantages, qui ne paient pas d’impôts, qui vivent comme des rois à La Haye, et en réalité, ce qu’ils font est une blague. Tout le monde connaît ce problème. Il ne s’agit pas seulement de la situation de la Géorgie. Alors vous en parlez à Amnesty, Human Rights Watch, la FIDH, qui travaillent avec la Cour depuis tant d’années. Mais la plupart du temps, personne ne nous a soutenus. Dans les ONG aussi, j’ai eu des amis qui m’ont dit : ‘Que crois-tu Nika, si je critique trop et que je le fais en mon nom, je perds mon emploi demain.’ Mais n’est-ce pas là toute l’idée de ces organisations : faire du bruit, se faire entendre ? »
« Comprenant tout cela, je leur ai dit, écoutez, ce n’est pas un travail pour moi, je préfère rentrer, je vais retourner dans mon village et je vais faire du vin. C’est un système qui est trop défectueux et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le changer », poursuit Nika. « Ce n’est pas que l’argent, c’est aussi parce que la plupart du temps ils viennent de pays qui n’ont pas connu la guerre. Ou alors la Seconde Guerre mondiale, mais c’est une autre génération. Ils ne savent pas parce qu’ils ne l’ont pas vue. Ils partent en mission, rencontrent des gens et se disent c’est grave. Mais après ils oublient, se font un bon dîner et rentrent dans leur pays. »
Dans les derniers temps de sa vie de juriste international, Nika commence à travailler sur le dossier afghan de la CPI et est sollicité sur celui de l’Ukraine. Puis, de retour en Géorgie, on lui demande de travailler comme avocat, avec des ONG. « Mais en ce moment, estime-t-il, du fait de la situation politique, une ONG ne peut pas faire grand-chose. Pour moi, ce serait juste prendre de l’argent pour, grosso modo, ne rien faire. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas devenir l’un de ceux que je ne respecte pas. » Seule concession à son ancien monde : « Parfois, je fais des traductions de documents juridiques, des révisions, ce que je peux faire le soir quand je reviens de la vigne, compte tenu du fait que je n’ai pas encore gagné d’argent avec mon vin, et qu’il en faut pour payer les factures. »
Retour aux racines
Nika n’imagine plus faire autre chose que du vin. « C’est excitant. J’ai le sentiment d’avoir trouvé ce que j’aime vraiment faire dans ma vie. J’ai beaucoup étudié, travaillé dur dans le domaine du droit, des droits humains, avec la CPI, etc. Avec le vin, c’est différent. Cela m’a vraiment rendu heureux. » Il ne peut cependant pas s’empêcher de voir un peu plus loin que le bout de ses vignes. Usant d’un de ses talents de sa vie d’avant, il a obtenu des fonds de l’agence américaine d’aide au développement USAID pour l’Association du vin naturel, fondée par son ami Zura, qui regroupe plus de cent producteurs en Géorgie. Il est allé à New-York rencontrer des distributeurs américains, qui sont à leur tour venus en Géorgie, fin février.
« J’espère que l’association va grossir, que les petites exploitations viticoles familiales vont signer des contrats. Ensuite cela peut influer sur beaucoup de choses », se prend à rêver Nika. « Le vin, en Géorgie, c’est notre truc. Il est profondément ancré dans notre tradition. À cause de l’Union soviétique, il s’est dégradé, parce qu’il n’y avait pas de demande de qualité, tout se résumait au nombre de litres et de bouteilles que vous produisiez. Lorsque l’Union soviétique s’est effondrée, ils ont poursuivi cette tendance, en particulier les grandes entreprises, en vendant les pires vins à la Russie. C’était un vin de merde. Après cela, il y a eu l’embargo russe, la guerre de 2008, et c’est à ce moment-là que nous avons commencé à travailler sur la qualité du vin. »
Faire du bon vin dans la Géorgie d’aujourd’hui, c’est peut-être une des seules façons honnêtes et réalistes de changer les mentalités, plaide Nika, de ne pas seulement blâmer le gouvernement pour ce qu’il ne fait pas et de revenir aux racines, les siennes et celles de son pays.



![« Je suis heureux ici, je respire, je me lève tôt et je travaille dur, mais je ne me sens jamais fatigué comme je l’étais durant ces années à batailler avec la CPI [Cour pénale internationale] », nous confie Nika Jeiranashvili, qui fait revivre les vignes du domaine familial de Kolagi, en Kakhétie, au sud-est de la Géorgie. Photo : © Franck Petit / Justice Info Nika Jeiranashvili raconte comment il est passé d'expert en justice internationale à expert du vin en Géorgie](https://www.justiceinfo.net/wp-content/uploads/Georgie_Nika-1_@Franck-Petit-Justice-Info-1000x666.jpg)