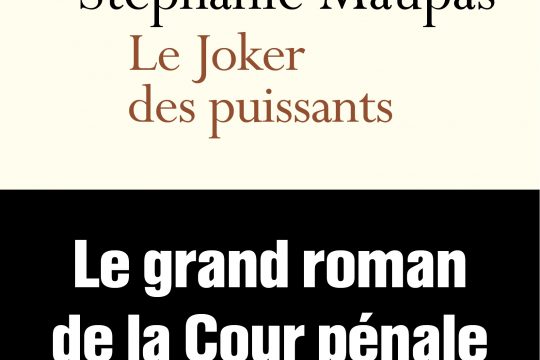En 2017, les Etats membres de la Cour pénale internationale (CPI) devraient promulguer les amendements de Kampala, donnant ainsi le feu vert à la juridiction pour poursuivre les auteurs d’ « agression ». Mais ce qui semblait une simple formalité fait de nouveau débat. La France et le Royaume -Uni, notamment, tentent de gagner du temps. La question ne sera pas traitée avant l’Assemblée des Etats parties en décembre prochain, mais des juristes craignent qu’elle soit repoussée indéfiniment.
C’est un crime de chefs. Un crime de dirigeant ciblant des présidents, leurs ministres, les chefs d’Etat-major. Sur le papier, la Cour pénale internationale (CPI) est compétente pour juger les auteurs d’ « agression ». Mais lors de l’adoption du Traité de Rome en juillet 1998, les diplomates avaient relégué à plus tard, faute d’entente, l’adoption d’une définition juridique de l’ « agression », et les modalités selon lesquelles la Cour en serait saisie. En mai 2010, les diplomates se retrouvaient donc à Kampala pour plancher sur l’épineuse question. « Les big boys, les membres en possession d’un droit de véto au Conseil de sécurité de l’Onu, souhaitent conserver leur droit de recours à la force. Ils estimaient qu’ils avaient seuls le pouvoir de déterminer si un acte était une agression », explique le professeur Don Ferencz, fondateur du Global Institute for the Prevention of Aggression. Comment un Etat peut-il protéger ses dirigeants de poursuites pénales pour « agression » ? C’est l’équation qu’avaient tenté de résoudre, avec un succès certain, « les big boys ». Après deux semaines de débats houleux, 111 Etats adoptaient une série d’amendements ouvrant la voie à de futures poursuites contre les auteurs d’ « agression ».
Conditions drastiques
Mais le compromis adopté à Kampala impose des conditions drastiques à la Cour. Le procureur ne pourra engager de poursuites pour « agression » qu’avec l’aval du Conseil de sécurité de l’Onu. Si ce dernier n’a pas acté l’existence d’un crime d’ « agression », le procureur devra lui demander son avis et faute de réponse dans les six mois, obtenir le feu vert des juges pour ouvrir une enquête. Mais les « big boys » auront encore la possibilité de brandir l’article 16, grâce auquel le Conseil peut suspendre, pour un an renouvelable, les procédures de la Cour si elles présentent un risque pour la paix et la sécurité internationale. Cerise sur le gâteau : une simple déclaration au greffe de la Cour permet à un Etat de s’exempter de ce crime. La négociation de Kampala avait été tendue et pour décrocher un consensus, les délégués avaient fixé l’entrée en vigueur de ces amendements à 2017, une fois leur adoption par 30 Etats puis leur promulgation par l’Assemblée des Etats parties, en 2017. Le 26 juin 2016, la Palestine a ratifié le texte, permettant d’atteindre ce cap (depuis, deux autres Etats ont ratifié ces amendements). Mais il n’a toujours pas été promulgué. A l’horizon de cette année fatidique, la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont renforcé l’offensive.
Gagner du temps
De concert, Paris et Londres ont proposé, à l’Assemblée réunie en novembre 2016, de mettre sur pied un nouveau groupe de travail, « pour développer une compréhension commune de la façon dont la juridiction sera exercée », disait le Britannique. L’Assemblée a accepté de désigner « un facilitateur », qui devra proposer un texte à l’approbation de la future Assemblée, prévue en décembre 2017. Les discussions sont « en phase préliminaire », indique-t-on au secrétariat des Etats parties. Londres et Paris ont donc gagné du temps. « Les Etats, qui n’ont pas ratifié l’amendement devraient pouvoir, à supposer qu’ils acceptent de les mettre en œuvre, connaître au minimum l’étendue de leurs obligations en la matière », justifiait l’ambassadeur de France aux Pays-Bas, Philippe Lalliot. Pour la France, les Etats qui n’ont pas ratifié les amendements devraient être de facto exemptés de poursuites pour « agression ». Faux, rétorquent de nombreux juristes. Même sans avoir ratifié les amendements de Kampala, l’Etat doit clairement indiquer, par courrier au greffier, son souhait d’en être exempté. «Le véritable enjeu n'est pas vraiment d'être forcé d'accepter la compétence indépendante de la CPI pour le crime d'agression, estime le professeur Ferencz, mais plutôt de savoir comment un État se présentera aux yeux du monde s'il se retire » dans le but « d’isoler ses dirigeants d'un éventuel contrôle judiciaire du crime d'agression. » Toute l’idée consiste désormais à s’exempter sur la pointe des pieds, car« si vous vous retirez, vous risquez d’en payer le prix politique », estime Romina Morello, de Parliamentarians for Global Action (PGA). Et Don Ferencz s’interroge : « Est-il possible qu'un État impliqué dans une action militaire juridiquement suspecte, risque l'opprobre potentielle qui résulterait d’un retrait de la compétence sur l’agression de la Cour, s'il ne croyait pas sérieusement qu'il y a un doute raisonnable quant à la légalité de ses actions ? »
L’opposition américaine
Les Etats-Unis n’ont pas ratifié le traité de la Cour, mais restent néanmoins d’actifs observateurs. En novembre 2016, accompagnant le concert franco-britannique, le délégué américain arguait « qu’il est dans l’intérêt de la paix et de la justice » de continuer à débattre de la question. Concernant les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide, la Cour est compétente pour juger les ressortissants d’Etats non parties au Statut de Rome qui commettraient ces actes sur le territoire d’un pays membre de la Cour. Mais ce n’est pas le cas pour l’agression. Pas de risque, donc, de voir un citoyen américain poursuivi pour ces faits. Washington craint néanmoins que l’activation du crime d’agression puisse refroidir ses futurs partenaires de coalitions militaires, notamment lorsqu’elle est enclenchée sans l’aval du Conseil de sécurité. Les Etats-Unis brandissent donc l’alibi humanitaire, affirmant, comme l’avait fait à Kampala le conseiller juridique du département d’Etat, Harold Koh, « que l’utilisation de la force est parfois légitime et nécessaire ». Mais pour Romina Morello, il n’y a pas de confusion possible entre un acte d’agression et une intervention à but humanitaire. « Une intervention humanitaire a pour but de stopper un génocide et des crimes contre l’humanité, et pas de changer un régime », explique-t-elle. Pour l’avocate, la définition adoptée ne paralyse en rien l’intervention à but humanitaire. « La résolution de l’Assemblée générale des Nations unies de 1974 prévoit que s’il n’est pas démontré que l’utilisation de la force va contre la Charte des Nations unies, on ne peut conclure à une agression. Et le Statut de Rome prévoit en outre que la nature, la gravité et l’ampleur doivent être suffisamment importantes », explique-t-elle.
Les Nations unies contre le crime contre la paix
Lors de l’Assemblée de novembre, l’Allemagne a fait entendre une voix discordante, rappelant le jugement d’octobre 1946 à Nuremberg, où l’agression était considérée comme « le crime international suprême ». Permettre à la Cour de s’emparer de l’agression « aura un effet préventif important sur les mentalités des décideurs », estime Berlin, soucieuse de préserver l’héritage de Nuremberg. Lors de la constitution de ce tribunal au sortir de la Seconde guerre mondiale, la question de l’agression suscitait déjà la controverse. Cette fois, les Etats-Unis y étaient favorables, mais Soviétiques et Français s’opposaient. Les premiers ne voulaient pas acter de précédent pour l’avenir, et proposaient de circonscrire le crime en pénalisant l’agression commise par les seuls « pays européens de l’axe ». Quant aux Français, ils estimaient que l’agression n’était tout simplement pas un crime et que si les nazis étaient criminels, ce n’était pas pour avoir déclenché une telle guerre, mais pour les atrocités qu’ils avaient commises. Au terme du grand procès des chefs nazis, l’Assemblée générale de l’Onu confirmait les principes de Nuremberg, le 11 décembre 1946, et demandait la codification des « crimes commis contre la paix et la sécurité de l’humanité ». Mais la guerre froide allait geler toute avancée, jusqu’aux négociations de Rome, à l’été 1998. Mais faute d’accord, un groupe de travail était mis sur pied. Don Ferencz se rappelle qu’à chaque réunion, la Russie, la Chine, les Etats-Unis, la France et le Royaume –Uni « se levaient un à un et chantaient la même chanson : la Cour ne peut poursuivre les auteurs d’agression que si le Conseil de sécurité l’a saisi. » Il évoque aussi l’offensive destinée à empêcher l’adoption d’un texte à Kampala. « Ils ont retourné la conférence de Kampala en un exercice d’inventaire » des premiers travaux de la Cour, pour tenter d’épuiser le temps normalement consacré à la négociation sur l’agression. Les manœuvres sont alors nombreuses, relayées mêmes par certaines ONG. Dans un courrier co-signé par quarante organisations, et adressé aux ministres des Affaires étrangères des Etats parties le 10 mai 2010, à la veille de la conférence, l’Open Society se dit « préoccupé par la codification du crime d’agression à Kampala », estimant que « les questions entourant la compétence de la CPI sur le crime d’agression sont complexes », et affirmant que « la proposition d’amendement actuelle risque de politiser et surcharger la CPI et de porter atteinte à l’intégrité du Statut de Rome ». Il faut donc remettre à plus tard la question, avance alors l’organisation du milliardaire George Soros.
Justice à deux vitesses
A l’heure où la Cour continue de susciter des critiques et où l’Union africaine exprime toujours avec force sa défiance, les réticences des Etats à activer le crime d’agression pourraient « offrir un nouvel argument, selon lequel elle n’est qu’une création néocoloniale », regrette Don Ferencz, qui craint que la question soit indéfiniment reportée. « La communauté internationale a créé cette Cour, qui a juridiction sur quatre crimes, ajoute Romina Morello. Si les Etats veulent réellement l’aider, ils peuvent signer les accords de coopération volontaire, exécuter les demandes d’assistance rapidement, augmenter son budget, mais certainement pas se débarrasser du crime d’agression ». Si les auteurs d’agression semblent encore bien loin du box des accusés de La Haye, activer sa compétence « enverra, au moins un message d’espoir », estime encore Don Ferencz. « Les études ont montré que lorsque quelque chose est illégal, cela le rend aussi plus amoral ». Il pose donc un cas d’école : que se serait-il passé si la Cour avait été compétente pour juger les actes d’agression, lorsque Tony Blair a décidé de s’engager aux côtés de George W. Bush en Irak ?