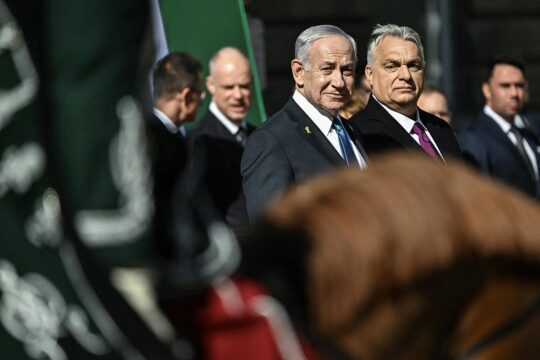Une organisation de soutien à la société civile syrienne a lancé une souscription pour financer le Mécanisme international, impartial et indépendant (M3I) sur la Syrie. Créé par l’Assemblée générale de l’Onu en décembre 2016, ce Mécanisme est censé rassembler les preuves récoltées au cours des sept premières années de guerre, et préparer des actes d’accusation clé en main, à destination d’un hypothétique tribunal. Mais alors que le Secrétaire général de l’Onu devrait annoncer dans les prochains jours le nom de celui qui prendra la tête du Mécanisme, son financement n’est toujours pas acquis.
La justice syrienne est-elle trop coûteuse pour les membres des Nations unies ? Créé en décembre 2016 par l’Assemblée générale des Nations unies, le Mécanisme international, impartial et indépendant (M3I), doit fonctionner grâce aux contributions volontaires des Etats. Mais depuis le vote de la résolution, les capitales, quand elles le font, y contribuent au compte-gouttes. Ce Mécanisme, censé centraliser les preuves collectées par des ONG, par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) et par la Commission d’enquête du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) n’a, pour l’instant, pas les moyens de fonctionner pleinement. Pour les deux premières années d’exercice, le budget prévu s’élève à plus de 12 millions d’euros. Jusqu’ici, une trentaine d’Etat a contribué, à hauteur de plus de 8 millions. Trop peu. La société civile est donc désormais invitée… à mettre la main au portefeuille ! Le 19 juin, l’organisation germano-syrienne Adopt a revolution a lancé une souscription en ligne, au titre évocateur, « Justice UN affordable ? » Puisque « les gouvernements continuent à hésiter, nous apporterons nous-mêmes justice à la Syrie » lit-on sur la pétition. Leurs auteurs espèrent collecter 1,9 millions d’euros d’ici le 27 août. « Même si nous n’atteignons pas la cible, expliquent-ils, chaque contribution enverra un signal clair aux gouvernements membres des Nations unies ». Au 20 juin à 13h, 153 donateurs se sont déjà manifestés, permettant d’atteindre 14% de l’objectif.
Au-delà des fonds nécessaires aux deux premières années de fonctionnement, les initiateurs du Mécanisme espèrent déjà une réforme : qu’il soit financé sur le budget régulier des Nations unies et non sur la base de contributions volontaires. Un gage de survie essentiel : les tribunaux ad hoc comme celui pour la Sierra Leone ont pâtis d’une telle méthode de financement, les forçant à frapper sans relâche à la porte des capitales pour pouvoir poursuivre leur mission. Un gage, surtout, d’indépendance. Le financement trop important de pays impliqués dans le conflit pourrait politiser la mission, craint-on du côté d’ONG. Peu après le vote de la résolution, de nombreuses ONG, syriennes et internationales, ont demandé que la participation de chaque Etat soit plafonnée à hauteur de 10% du budget. On pensait notamment au Qatar, dont l’activisme fait grincer des dents. L’allié d’Al Nosra, l’une des organisations djihadistes en Syrie, « veut marquer des points politiques », estimait ainsi un défenseur des droits de l’homme. « Doha se paie une diplomatie à moindre frais », soulignait une experte de la justice internationale. L’inscription du Mécanisme au budget régulier de l’Onu est d’autant plus importante que le vote de décembre 2016 n’a, sans surprise, pas fait l’unanimité. Moscou et Téhéran ont dénié à l’Assemblée générale le pouvoir légal de créer un tel organe. A quelques semaines des premières négociations de janvier 2017 à Astana, entre le régime de Damas et une partie de son opposition, sous l’égide de la Russie, la Turquie et l’Iran, Moscou avait dénoncé une « ingérence » dans les affaires syriennes, risquant « de saper les perspectives de paix ». De leur côté, le Qatar et les pays du Golfe avaient apporté leur appui enthousiaste à ce Mécanisme. Tandis que Damas fustigeait une résolution soutenue par « les parrains du terrorisme », et que l’Arabie Saoudite rétorquait en mettant dos à dos le Hezbollah et le régime syrien. L’acte de naissance de ce Mécanisme était d’ores et déjà politiquement marqué par les lignes de fracture creusées dans le sillage de la guerre syrienne. La question du budget, de son fonctionnement, de ses chefs n’en est évidemment que plus sensible. Mais pendant qu’on débattait dans l’enceinte des Nations unies, de nombreux enquêteurs poursuivaient des recherches engagées dès les premiers mois de la guerre. Et la guerre syrienne continuait de charrier ses cadavres, faisant de la mort l’ordinaire d’un pays exsangue.
Des preuves, pas de tribunal
« Face à toutes les preuves que nous avons, face à toute cette documentation, face à tout ce qui se déroule », expliquait Christian Wenaweser après le vote de la résolution, ce mécanisme est « un premier pas dans la bonne direction ». Un organe « pas parfait, parce que nous n’avons pas de tribunal qui a juridiction » ajoutait l’ambassadeur du Liechtenstein à New York, à l’origine du projet. Depuis le début de la guerre en Syrie en mars 2011, toutes les initiatives de justice internationale ont échouées. Celle vers laquelle tous les regards se sont d’abord tournés, la Cour pénale internationale (CPI), n’est pas compétente : Damas n’a pas ratifié le traité l’établissant. Seul le Conseil de sécurité des Nations unies aurait donc pu la saisir, mais en mai 2014, Moscou a mis son veto à un projet de résolution mort-né proposé par la France. Depuis, les appels à la Cour continuent, peine perdue. En février, des intellectuels syriens adressaient une lettre ouverte au Secrétaire général de l’Onu. Se basant sur « le rapport César », une expertise de 55 000 photos montrant 11 000 morts dans les prisons du régime, clichés exfiltrées par un médecin légiste, et sur l’enquête d’Amnesty International dénonçant la mort de 5000 à 13 000 personnes dans la prison de Sadnaya, proche de Damas, ces intellectuels demandaient une saisine de la Cour « pour sauver les détenus survivants, et condamner publiquement toutes les personnes responsables de ces crimes commis dans les prisons syriennes ». Devinant que la CPI ne serait sans doute jamais saisie, et préférant se tourner vers une autre juridiction que cette Cour pas tout à fait universelle, et dont le bilan n’est pas reluisant, des juristes ont commencé à plancher dès 2012 sur la création d’un tribunal ad hoc. Un projet de statut a même été rédigé. Mais il partait du postulat que de nouvelles autorités prendraient rapidement le pouvoir en Syrie. Or la guerre s’est poursuivie et étendue. Faute de juridiction internationale, des procureurs européens ont, depuis 2013, engagé plusieurs procédures au titre de la « compétence universelle ». Elle permet de juger les auteurs étrangers de crimes commis à l’étranger. L’Allemagne, la France, la Suède, les Pays-Bas, la Suisse, et l’Espagne ou ouvert des dossiers. Mais n’ont pas, à ce jour, permis de juger les plus hauts responsables.
Pièces à conviction
Pourtant, des milliers de pièces à conviction sont déjà à la disposition d’un futur procureur. Il ne manque qu’un tribunal. Depuis le début de la guerre, de nombreuses organisations de défense des droits de l’homme ont collecté preuves et témoignages. La Commission d’enquête internationale sur la Syrie, mise en place par l’Onu dès 2011, a produit une vingtaine de rapports détaillant les crimes commis par le régime, les rebelles et les groupes djihadistes. Et une enquête, conduite conjointement par l’Onu et l’Organisation pour l’interdiction et la prévention des armes chimiques (OIAC), est toujours en cours. Elle doit désigner les auteurs de neuf attaques conduites en Syrie. Sur les quatre analysées à ce jour, trois attaques au chlore seraient le fait de l’aviation syrienne, et une au gaz moutarde aurait été perpétrée par l’Etat islamique (EI). Mais pour l’instant, les responsables n’ont pas été nommément désignés. A toutes ces preuves s’ajoutent aussi celles émanant d’organisations privées, comme la Commission international for Justice and Accountability (CIJA). Depuis 2012, des syriens ont récoltés non pas des témoignages, mais des documents émanant du régime, sortis quasiment à dos d’homme de Syrie : des ordres notamment, permettant de remonter, preuves à l’appui, la chaine de commandement. L’organisation, qui travaille avec des procureurs internationaux et des analystes aguerris, a déjà produit un document qui pourrait tenir lieu d’acte d’accusation contre 24 responsables du régime.
Des dossiers clé en main
Ce sont tous ces éléments que le Mécanisme devrait donc désormais centraliser, vérifier, et analyser, avant de constituer des dossiers clés en main. Faute de tribunal spécial, on table beaucoup sur la compétence universelle et les poursuites engagées en Europe. Une fois en place, de nombreuses questions juridiques se poseront au Mécanisme. Une équipe restreinte planche déjà. Comment protéger les témoins ? Sur la base de quel droit faudra-t-il constituer les dossiers ? « Dans certains systèmes juridiques, existe, par exemple, le droit à ne pas s’auto-incriminer lors d’un interrogatoire, alors que dans d’autres systèmes, ce n’est pas un problème », explique un juriste. Comment tracer la provenance des preuves ? Beaucoup s’interrogent aussi sur les pièces récoltées pendant la guerre et émanant du régime. Sont-elles la propriété de l’Etat syrien ? Au cours d’une conférence de presse mi-mai, le directeur général de l’OIAC, Ahmet Uzumcu, expliquait aussi toute la difficulté qu’il y aurait à partager des documents fournis par des Etats. Rien ne pourra se faire sans leur accord, au cas par cas. Les actes fondateurs du Mécanisme apportent déjà certaines réponses. Les preuves qu’il collectera seront classées confidentielles, et elles ne pourront être partagées qu’avec des régimes démocratiques où des procédures sont engagées, et qui ne pratiquent pas la peine de mort. Des preuves des crimes commis en Syrie n’attendent qu’à parler, des procureurs sont prêts. Et s’il n’existe toujours pas de tribunal sur la Syrie, Bachar Al-Assad a déjà une ligne de défense. Dans une interview publiée par l’agence Sana le 7 février, le président syrien expliquait devoir « défendre notre pays par tous les moyens, et quand nous devons défendre par tous les moyens, nous ne nous soucions pas de cette Cour ou d’une quelconque institution internationale ». Il ajoutait que « les institutions des Nations unies ne sont pas impartiales, elles sont biaisées en raison principalement de l’influence américaine, française et britannique ». D’autres avant lui, ont brandi les mêmes arguments devant les tribunaux ad hoc : défendre, oui, mais dans les limites du droit de la guerre, ont répondu les juges. Ni par tous les moyens, ni contre les civils, ni au prix de 300 000 morts.