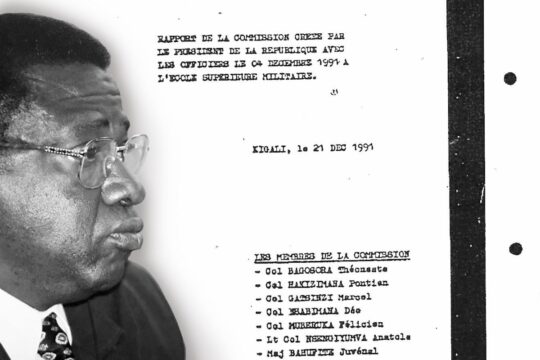Au lendemain du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, entre avril et juillet 1994, l’Etat rwandais est exsangue. Au milieu de leurs habitations rasées, des villes éventrées, des collines lardées de charniers et de fosses communes, de terres dépeuplées et d’infrastructures ravagées, les survivants, et parmi eux notamment des enfants et des nourrissons esseulés, des malades affamés et sans abri, se comptent par milliers. L’Etat a été vidé de ses ressources, pillé jusqu’au dernier centime par ses représentants qui ont fui vers le Zaïre voisin (le Congo d’aujourd’hui). C’est à ceux qui ont pris le pouvoir et arrêté le grand massacre qu’échoit l’impossible équation : comment aider ces rescapés à remonter de l’abîme et à combler leurs besoins élémentaires pour une réhabilitation socio-économique ?
Sous l’empire de la Loi organique du 30 août 1996 sur la répression du génocide, un premier pas est franchi : les premiers procès contre les auteurs du génocide consacrent la responsabilité de l’Etat rwandais. L’Etat est condamné par les tribunaux ordinaires à payer des sommes colossales pour le génocide commis en son nom. Les autorités reconnaissent le principe de la continuité de l’Etat. Le crime ayant été commis en son nom, elles acceptent de verser chaque année, non des dommages et intérêts, mais un pourcentage de son budget annuel au Fonds d’assistance aux rescapés du génocide (FARG), pour les plus démunis. Selon la loi qui crée le FARG, celui-ci est essentiellement alimenté par le versement de 6% du budget national annuel, ou plus exactement des recettes internes. Avant l’amendement de cette loi, en 2008, chaque salarié du secteur public ou privé doit donner une contribution équivalant à 1% de son salaire brut. Mais le fonds peut aussi recevoir des contributions des partenaires locaux et internationaux, organisations et associations locales ou internationales, personnes physiques ou morales.
Imararungu, la vache qui brise la solitude
Dancilla Mukankusi a survécu au massacre de Kabarondo, une église de l’Est du Rwanda dans laquelle ont péri, en l’espace d’une demi-journée, le 13 avril 1994, plus de 2000 réfugiés tutsis, dont toute sa famille. Aujourd’hui, à 63 ans, elle souffre de tous les maux dont une hépatite, une insuffisance rénale, des troubles cardio-vasculaires et autres maladies chroniques. Même pour ses voisins, elle est celle qui « passe plus de temps sur un lit d’hôpital et vit de médicaments ». Dancilla le reconnaît clairement : « Je crois que sans l’aide du FARG, j’aurais déjà succombé. » En plus de ces soins médicaux, elle reçoit une petite somme d’argent en guise d’aide directe qui l’aide à survivre tant bien que mal.
Dans le district voisin de Rwamagana, Odette, une autre veuve du génocide, âgée de 67 ans, vit presque dans les mêmes conditions que Dancilla. Lorsqu’on l’interroge sur la façon dont elle vit sa solitude, elle répond qu’elle a une compagne. Qui est-ce ? lui demande-t-on. Avec un petit rire désinvolte, elle se dirige vers une petite étable et chuchote à l’oreille d’une grande frisonne en train de ruminer son herbe, le nom d’ « Imararungu » – celle qui brise la solitude, en langue kinyarwanda. La dame explique sa journée : Imararungu lui prend presque tout son temps pour tous ses soins, du matin au soir, comme « un enfant chéri, un bon compagnon que AVEGA m’a donné ». AVEGA, c’est l’Association des veuves du génocide, partenaire du FARG dans la réhabilitation des victimes du génocide.

Pour les voisins, son vrai nom importe peu, elle est « la vieille avec la vache du FARG » ! Mais pour Odette, « Imararungu tient la place de toutes les vaches pillées et abattues » lors du génocide. Et elle est un grand réconfort. La vache, traditionnellement perçue comme un signe de privilège du Tutsi éleveur, fut ciblée pendant le génocide, au chant de ralliement : « Mangeons les vaches des Tutsis ! » Odette fait partie des 7510 veuves qui ont bénéficié d’une vache depuis la mise en place du Fonds.
Un bilan plutôt satisfaisant
Le pari du FARG en vue d’assurer la réhabilitation socio-économique des rescapés du génocide, sur fond de programmes déjà existants, a ainsi fonctionné selon cinq axes d’intervention : fourniture de soins médicaux aux malades, aide directe aux plus vulnérables, facilitation de l’éducation pour des milliers d’enfants, dont plusieurs orphelins chefs de famille, logement de tous les sans abri et aide à la création d’activités génératrices de revenus. Selon un bilan dressé en juin 2018, c’est-à-dire après vingt ans d’exercice, le fonds a payé des soins médicaux à plus de 2 millions d’occasions, y compris pour 428 patients traités à l’étranger, pour un coût total de près de 19,5 milliards de francs rwandais (19,3 millions d’euros). Près de 110 000 enfants et orphelins ont pu bénéficier du programme éducation, à tous les niveaux et jusqu'à l’université. « Cela fait un grand plaisir de ménager de telles vies mises en danger et fragilisées par le génocide. Nous sommes satisfaits des résultats », se réjouit Théophile Ruberangeyo, directeur générale du FARG, qui estime que certains des bénéficiaires du Fonds ont franchi toutes les étapes du programme, à savoir « la réhabilitation, la réintégration et la graduation ». Par exemple, « des orphelins d’hier, nous avons fait des hommes et femmes responsables devant leurs familles et leur patrie », ajoute-t-il.
Le Fonds se prévaut également de la construction de quelques 45 000 logements, dont certains dans des villages de « réconciliation » où cohabitent victimes et anciens bourreaux, ainsi que 54 000 bénéficiaires d’activités génératrices de revenu. Avec l’aide du programme « One dollar campaign », projet lancé par la diaspora rwandaise, un grand immeuble abrite à Kigali quelques 192 élèves et étudiants orphelins du génocide, naguère sans-abri et contraints de passer les vacances dans leurs écoles.
Après vingt ans d’exercice, les quelque 272 milliards de francs rwandais (270 millions d’euros) absorbés par le Fonds sur tous ses axes d’intervention ne sont qu’« une goutte d’eau dans un océan de problèmes », estime pourtant Théophile Ruberangeyo. Car ce montant, regrette-t-il, reste dérisoire au regard des besoins et du nombre de victimes.
De nombreuses critiques
Le Fonds a aussi été confronté à de nombreuses critiques : malversations, maisons construites de façon tronquée pour ne durer que 5 à 10 ans, corruption dans la sélection des bénéficiaires allant jusqu'à en faire profiter d’anciens miliciens ! En 2010, suite à un contrôle minutieux, plus de 17 000 cas de tricherie avaient été décelés et 47 entrepreneurs malhonnêtes identifiés et traînés en justice.
Mais les défis ne se résument pas à la mise en œuvre du Fonds. Déjà, en 2009, le collectif des associations de rescapés du génocide Ibuka [souviens-toi, en langue rwandaise], dénonçait le fait que, en lieu et place d’une indemnisation des préjudiciés, l’Etat a opté pour la création du FARG que « même les victimes sont condamnées à alimenter pour payer leur propre réparation », comme le cingle Denis Bikesha, professeur de droit à l’Université du Rwanda. Pour lui, « la réparation des victimes doit être comprise comme un droit et non une faveur ».
Au cours d’une réunion de rescapés du génocide, en décembre 2018 à Rusizi, au sud-ouest du Rwanda, les participants ne sont pas plus cléments. Génocide ou pas, disent-ils en substance, l’Etat n’a-t-il pas l’obligation de pourvoir aux plus vulnérables et aux déshérités ?, s’interroge Laurent Ndayambaje, président local d’Ibuka. « Nous voulons nos droits, pas des privilèges », dit-il sèchement. Même si le FARG accomplit de bonnes choses pour « nos veuves, orphelins et tous les vulnérables », dit-il, ses services sont perçus, d’un côté, comme « une faveur à demander et, de l’autre, comme une faveur à octroyer ». Avec l’organisation des procès – des centaines de milliers de Rwandais ont été jugés pour leur participation au génocide, notamment à travers des tribunaux communautaires appelés gacaca –, on a eu « la vérité » et « les coupables punis », reconnaît Ndayambaje. Mais pour une justice pleine, conclut-il, il fallait « juste un petit pas vers la réparation, même symbolique ».
Comme le conclut un ancien parlementaire retraité, pour un Etat, « il est plus facile d’organiser que d’arrêter un génocide et/ou d’en réparer les séquelles ».
L'IMPOSSIBLE INDEMNISATION
Qui a droit à réparation ? Les victimes ayant porté plainte dans une affaire ou toutes les personnes identifiées comme victimes au niveau de la communauté ? A qui incombe l’obligation de réparation : aux individus reconnus coupables et condamnés, à l’Etat rwandais, ou encore à la communauté internationale ? Ces questions ont été posées dès le lendemain du génocide au Rwanda, sans qu’elles évoluent beaucoup avec le temps.
Selon la loi de 1996 organisant les poursuites pour génocide et crimes contre l'humanité commis entre 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, les victimes peuvent se porter partie civile et demander réparation pour des dommages physiques ou moraux. Au sein de chaque tribunal de première instance est alors créée une chambre spécialisée chargée de ces procès. A l’issue de ceux-ci, des particuliers et l’Etat ont été condamnés à verser d’énormes sommes d’argent au titre de dommages et intérêts. Pourtant, très vite, l’exécution de ces jugements s’est heurtée à deux gros écueils : l’insolvabilité des condamnés et l’impossibilité pour le gouvernement de s’acquitter de cette colossale obligation alors qu’il organisait également son assistance aux plus déshérités des survivants, notamment par le biais du Fonds d’assistance rescapés du génocide.
« Un déni de justice majeur »
Tirant les leçons des chambres spécialisées, la loi sur les juridictions populaires Gacaca n’a pas prévu la possibilité d’une action civile. Devant ces tribunaux, les personnes reconnues coupables d’infractions contre les biens et propriétés sont simplement tenues de réparer ou restituer ces derniers. Aucun dommages et intérêts pour une femme devenue veuve à cause du génocide, ni pour un vieil homme dans le dénuement du fait que sa progéniture a été décimée en 1994, ni pour une personne handicapée à vie par les coups et blessures reçus pendant les massacres.
Même lacune devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), installé par l’Onu en Tanzanie et qui a clos ses travaux fin 2015. Jean-Pierre Duzingizemungu, président d’Ibuka, la principale organisation de survivants du génocide, l’avait dénoncé devant les responsables du TPIR lors des 20èmes commémorations du génocide, en avril 2014. « Pour les survivants, réparation signifie restitution et compensation pour les dommages moraux et matériels, réhabilitation et garantie de non-répétition », avait-il déclaré. Pour Naphtal Ahishakiye, secrétaire exécutif d’Ibuka, ce vide juridique au TPIR et dans les Gacaca constitue, pour les rescapés, « un déni de justice majeur ». « Tout compte fait, c’est comme si toute la justice n’avait pas voulu nous faire justice», avait-il résumé.
A l’issue des gacaca, en 2012, une loi avait été prévue sur l’exercice des réclamations. Six ans plus tard, on n’en parle plus. L’exécution même des jugements relatifs aux biens pillés ou détruits trébuche. Quelque 69 000 dossiers, sur les 2 millions de jugements exécutoires qui auraient été prononcés, sont encore pendants. Un vrai casse-tête pour le ministre rwandais de la justice qui, fin janvier, a relancé pour la énième fois la campagne de sensibilisation à la restitution des biens pillés et détruits pendant le génocide. Encore « un jeu de cache-cache », ironise un rescapé à Kigali.